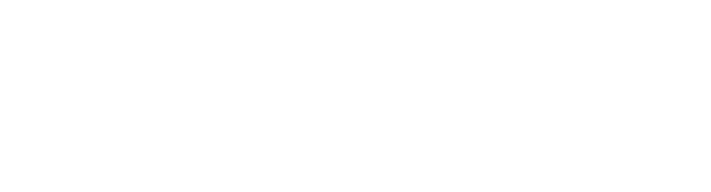« Les granites à mica blanc et les pegmatites sont très abondants dans le Massif armoricain ; les kaolins provenant en général de leur altération, il y a lieu de les rechercher partout où ces roches existent. On en connaît déjà un certain nombre de gisements, dont quelques-uns ont été exploités, mais il est certain qu’il en existe un bien plus grand nombre ». Yves Milon, 1936
À ce jour, le massif granitique du Huelgoat (Finistère) s’avère particulièrement intéressant. Le gisement du Menez Molvé à Berrien, récemment abandonné, fournit un exemple démonstratif de kaolinisation hydrothermale, précédée ici par processus pneumatolytiques2 (greisenisation et tourmalinisation). Le gisement du Menez-Du à Loqueffret (photo 1) qui a pris le relais, s’avère également fort instructif.
Photo 1 - Gisement de kaolin de Loqueffret
À gauche, grès armoricain du Menez-Du.
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 21 mars 2012
Les autres massifs granitiques où de nombreux indices ont été récemment mis en évidence sont présentés plus succinctement, dans le cadre d’une gîtologie prévisionnelle. L’accent est mis sur les méthodes de recherche préliminaires des zones favorables où géomorphologie, mais aussi botanique, s’avèrent être des guides précieux avant l’implantation des sondages.
Avant-propos
Le mot « kaolin » ou, plus précisément, « kaoling », est d’origine chinoise et signifie textuellement « haute colline », l’une des matières premières entrant dans la fabrication de la porcelaine étant extraite d’une colline située près de King-Te-Ching, portant ce toponyme…
Des traces d’exploitation de la matière argileuse qu’en France on ne dénommait pas encore kaolin, remontant au Xe siècle – et peut-être même à l’époque mérovingienne – ont été découvertes à Heloup près d’Alençon par Le Thellier. Cette même substance est également signalée à Aulnay, toujours près d’Alençon, en 1503 (Nicolas, 1957). Et c’est encore dans le même district d’Alençon que devait être reconnu par Guettard (1765), vers le milieu du XVIIIe siècle, le kaolin authentifié en tant que tel, et exploité, semble-t-il, pour la manufacture de Sèvres.
Les toponymes significatifs tels que – en langue bretonne – Toulpri et Poulpri, et encore Poulprio, Poulloupri, Poul-Prienne, Streat-Prioc, Briel, Briellec… (avec la racine pri = argile) (Tanguy, 1975) ; et les lieux-dits « La Poterie », doivent cependant être considérés avec circonspection, car ils peuvent se rapporter à des matériaux argileux autres que la kaolinite, nettement moins « nobles », partant, moins estimés et souvent de genèse différente (origine supergène) et, par suite, hors de nos propos.
Selon les cas, la kaolinisation peut être d’origine hydrothermale – c’est-à-dire liée à des facteurs d’origine profonde –, ou météorique – à savoir associée à une altération superficielle. La kaolinite est un silicate hydraté appartenant au système triclinique. Elle se forme préférentiellement aux dépens des feldspaths selon la réaction suivante :
4 KAlSi3O8 (Feldspath potassique) + 4 H2O → Al4Si4O10(OH)8 (Kaolinite) + 8 SiO2 (quartz) + 2 K2O
4 NaAlSi3O8 (Feldspath sodique) + 4 H2O → Al4Si4O10
(OH)8 + 8 SiO2 + 2 Na2ODepuis les lointaines recherches de Guettard, l’Ouest de la France occupe aujourd’hui – et de loin – la première place pour la production de kaolin dans notre pays. Dans cet article, nous nous limiterons toutefois aux gisements associés au batholite hercynien médio-armoricain et ses approches, où les occurrences sont très nombreuses, localement exploitées, mais plus souvent, encore mal connues.
Le but de ce mémoire est de rassembler les observations que nous avons effectuées depuis une cinquantaine d’années sur les occurrences de ce batholite où de nombreux indices sont à peine mentionnés, voire encore inédits. L’un des objectifs du travail présenté ici est de fournir des informations sur les sites, dont l’intérêt encore potentiel pourrait, un jour, dans certains cas, se révéler réel : non pas tant peut-être l’occurrence elle-même que le district méconnu qu’elle laisse soupçonner. Notre présentation aura ainsi une connotation de gîtologie prévisionnelle. Pour fonder cette prospective sur des bases solides, il est évidemment nécessaire d’exposer avec quelques détails les données acquises à ce jour.
Dans quelques cas, la découverte peut être due au hasard : ainsi, selon nos informations, le gros gisement du Menez Molvé en Berrien (vers les années 1960 ?) dévoilé à la faveur de travaux routiers entre Berrien et Scrignac, travaux motivés par la mauvaise tenue de la route due à son établissement… sur le kaolin.
Le passage entre la découverte de l’indice de sub-surface et la mise en évidence d’un gîte exploitable industriellement est loin d’être simple. Vu les investissements mis en œuvre dans l’usine de traitement, on estime aujourd’hui qu’un gisement d’intérêt économique doit renfermer au moins 6 millions de tonnes de produits bruts tout venant (sauf s’il existe déjà une usine de traitement à proximité). En outre, tous les kaolins n’offrent pas le même intérêt et les mêmes qualités, d’où la nécessité d’essais semi-industriels très poussés. Les méthodes de reconnaissance des gisements en profondeur font appel à la géophysique : prospection électrique (résistivité : sur kaolin ≤ 300 ohms ; sur granite ~ 700 ohms) ; gravimétrie (basée sur la différence de densité ; à Ploemeur, batholite de Bretagne méridionale, leucogranite sain : ~ 2,63 ; leucogranite kaolinisé : ~ 2,04) ; complétée par des sondages de grand diamètre.
La figure 1 schématise succinctement les occurrences de kaolin d’origine hydrothermale en Bretagne. Comme indiqué, seules les occurrences associées au batholite hercynien médian armoricain sont envisagées dans ce mémoire (fig. 2). La ceinture batholitique hercynienne médio-armoricaine s’étend d’une manière discontinue de Saint-Renan à Dinan où elle se termine devant le système de failles de la Rance, accident transversal majeur du Massif armoricain. À l’ouest, le granite de Saint-Renan est intrusif dans des complexes fortement métamorphiques (gneiss à sillimanite, anatexites) ; plus à l’est, les plutons peuvent recouper des formations faiblement métamorphiques (jusqu’au Viséen inclus pour le granite de Quintin). En première approximation, le batholite offre une liaison d’ensemble avec le linéament médio-armoricain ; cependant, dans le détail, la mise en place des différents plutons est contrôlée, au moins en partie, par des structures préexistantes (WSW-ENE ou NNE-SSW) d’où l’allure en échelon très caractéristique des massifs. Ce sont des intrusions de type polyphasé, avec dans les cas les plus complexes (Plouaret), successions de venues plus ou moins emboîtées : diorites, granodiorites à amphibole, monzogranites porphyroïdes à biotite, leucogranites. Les mises en place s’échelonnent entre ~ 340 et ~ 300 millions d’années.
Tous les plutons de cette ceinture – excepté, curieusement, semble-t-il, celui de Saint-Renan – sont plus ou moins affectés par des processus de kaolinisation hydrothermale.
PLounéour-Menez
Les occurrences sont nombreuses et encore mal connues (fig. 3) (Chauris et Garreau, 1983).
Vers la bordure méridionale du granite dit de Commana (à l’ouest du pluton polyphasé) : au sud de Roz ar Hoël et de Créac’h an Drel au nord de Saint-Cadou ; Toulloudan au sud de Commana).
À l’intérieur de la partie centrale du granite de Commana (Kerfeos au nord du Drennec).
Dans le granite de Plounéour-Menez au sens strict (dit aussi du Cloître) : près de Quillien au sud du Cloître ; au sud-est de Pleyber-Christ : Trévalan, sud de Créach Meot Bihan.
Dans le granite de Lannéanou : à environ 3 km à l’ouest du bourg ; à la sortie sud du bourg ; au Menez Blevara.
Quelques petits indices ont été également observés au nord du pluton principal ; sud de Kerleo à l’ouest de Botsorhel ; Cosquer-Pinar au nord-est de Plourin (en dehors de la figure 3).
Le processus de kaolinisation apparaît ainsi indépendant du granite affecté. Il est lié essentiellement au développement de fracturations importantes, soulignées à présent par des filons quartzeux, parfois très puissants, d’orientation préférentielle subméridienne. Dans le district de Lannéanou, les filons de quartz jalonnent le passage d’une zone de faiblesse transverse qui se poursuit bien au-delà du granite. L’occurrence de kaolin la plus remarquable est ici celle du Menez-Blevara, en association avec un énorme faisceau quartzeux, tracé depuis le NE de Pen ar Veleugen jusqu’au SW de Guernelohet. À l’affleurement, les principales zones kaoliniques se manifestent par des surfaces subhorizontales, recouvertes de landes ou de mauvaises prairies, où les moindres excavations forment çà et là des taches blanchâtres très caractéristiques.
À titre d’exemple de notre méthode de recherche des occurrences de kaolin, voici quelques annotations sur un indice découvert à Pleyber-Christ (Chauris, 2015). Situé dans le massif granitique de Plounéour-Menez, il s’étend à proximité de sa bordure septentrionale ici jalonnée par des cataclasites et des mylonites (Traongoff, Kerrohan, Lesloc’h, Moulin du Clos) soulignant le passage du linéament médio-armoricain ; au nord du granite, les formations schisteuses rapportées au Dévonien sont localement très riches en gros cristaux de chiastolite3 (Créac’hmeot-Bihan, nord-ouest de Kergalein).
Alors que, le plus souvent, le granite de Plounéour-Menez forme à l’affleurement un moutonnement de collines parsemées de boules parfois énormes, à environ 2,5 km au sud-est de Pleyber-Christ s’étend une vaste zone remarquablement aplanie, subhorizontale (cotes 144-147 m de la carte I.G.N.) (fig. 4). À cette morphologie plane en fort contraste avec les croupes environnantes, se superpose la fréquence de zones humides, se traduisant par la prolifération des joncs et des molinies dans de mauvaises prairies et par la présence de mares qui, indiquant une stagnation des eaux, laissent pressentir un sous-sol argileux (photo 2).
Photo 2 - Molinie (Molinia cerulea) sur zone kaolinisée à Pleyber-Christ
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris
Effectivement, l’examen des fossés en bordure des champs et des chemins décèle l’affleurement d’un granite kaolinisé. À l’ouest de Lesloc’h, un récent abattage d’arbres révèle sous une terre noire humifère, des amas blanchâtres de kaolin.
Le quartz filonien est abondant, en éléments épars à la surface du sol. À l’évidence, il était initialement encore plus fréquent, comme l’attestent non seulement les tas d’épierrage à la limite des parcelles, mais aussi sa présence dans les talus et même dans les murs des vieilles demeures (Trévalan…). Il s’agit d’un quartz blanchâtre, le plus souvent massif, avec localement des fissures tapissées de petits cristaux. La médiocrité des affleurements dans cette zone aplanie rend généralement la direction des filons difficile à déterminer ; elle paraît osciller autour d’un axe nord-sud ; près de Trescalan, le filon est orienté approximativement N15°E.
En l’absence de sondages, l’importance de l’occurrence s’avère délicate à estimer. Dans l’état actuel des investigations superficielles, son extension tant est-ouest que nord-sud serait de l’ordre d’au moins 750 mètres. Toutefois, selon toute probabilité, l’ensemble de cette zone ne semble pas avoir été affectée entièrement par les processus hydrothermaux.
Plouaret - Le Yaudet
Dans le pluton de Plouaret, typiquement polyphasé, d’énormes filons de quartz tardifs, souvent en relief, suivis sur plusieurs kilomètres, parfois dédoublés et d’une puissance totale atteignant plusieurs dizaines de mètres, soulignent l’ampleur des processus de silicification hydrothermale. Ces processus se sont effectués aux dépens de granites broyés, avec formations de silice rouge à grain fin avec texture bréchique, de quartz blanchâtre en grosses cristallisations de quartz ferrugineux brunâtre et d’améthyste. Dans quelques cas, les filons se poursuivent au-delà des limites du pluton. La kaolinisation, étroitement liée à la silicification, s’est développée fréquemment dans les épontes sur des puissances pouvant atteindre quelques dizaines de mètres, d’où l’allure longiligne des occurrences (kaolin de crête). Ces processus deutériques tardifs, à température modérée, qui reflètent la présence de circulations hydrothermales en relation avec de grandes fractures, sont sans lien direct avec une venue particulière du pluton. D’ouest en est, les principales zones kaoliniques sont les suivantes : Beg ar Menez-La Garenne ; Lan Ebourg-Kervinihy ; Keranfloch-Kergrist ; Min Toul-Kerouspy–Lanveur ; Kervegan (à l’WSW de Mantallot)… Le granite kaolinisé a naguère été exploité à Keranfloc’h pour les papeteries Vallée, de Belle-Isle-en-Terre.
Dans le petit pluton du Yaudet affleurant au nord du massif de Plouaret, un indice de kaolin a été découvert sur l’estran près de Poulma-Doguen, sur la rive sud de l’embouchure du Léguer, au contact d’un filon de quartz E-W intra-granitique, localement riche en pyrite disséminée dans une gangue calcédonieuse gris-rougeâtre, avec fantômes de carbonate silicifié. L’analyse minéralogique du granite kaolinisé de Poulma-Doguen4 a montré (en %) : kaolinite (38), mica (5), quartz (36), feldspath (21). Près du château de Coat Trédrez, le granite est plus ou moins kaolinisé au passage d’un filon quartzeux.
Huelgoat
Les gisements reconnus dans le massif polyphasé du Huelgoat fournissent un excellent exemple de district totalement insoupçonné voici quelques dizaines d’années et devenu aujourd’hui un des principaux producteurs de kaolin en Bretagne, avec le gisement du Menez-Molvé en Berrien, en exploitation depuis la seconde moitié des années 60 et, à présent, arrêté (2017), et le gisement du Menez-Du en Loqueffret, en cours d’exploitation. Quelques autres occurrences sont à ce jour mal connues. Tous ces gîtes ont en commun d’être localisés à la bordure même du massif (fig. 5).
Figure 5 - Esquisse géologique du pluton du Huelgoat.
Localisation des occurrences minéralisées.
D'après Barrois, 1902 ; Conquéré, 1965 ; Georget, 1986 ; et levers personnels inédits
La localisation du pluton du Huelgoat au sud de celui de Plounéour-Menez, dont il est séparé par la crête rectiligne des Monts-d’Arrée, pose un problème. Les données gravimétriques suggèrent que cette séparation ne se manifeste qu’en surface (Chauris, 1977, 2021). Selon cette manière de voir, le pluton du Huelgoat est interprété comme une grosse loupe, enracinée au nord et déversée vers le sud. Un déversement au sud a été également proposé pour le massif de Quintin (Chauris, Lulzac et Germain, 1990). Plusieurs venues différentes constituent le pluton du Huelgoat, typiquement polyphasé (Conquéré, 1969 ; Georget, 1986).
Au nord, un granite à gros grain, à biotite, dit de La Feuillée, passe vers l’ouest, vers le nord et vers l’est à un granite à deux micas, dit de Berrien (fig. 5). Localement, à sa bordure, ce dernier granite présente diverses différenciations : aux environs de Roz-Du en Botmeur, un faciès aplitique à muscovite ; au nord-est de Trédudon-Le-Moine, des pegmatites à muscovite, tourmaline et petits béryls : à un kilomètre au sud-est du Roc’h Trédudon, émissions de filons aplitiques dans le Grès armoricain encaissant fortement laminé (faille de l’Arrée). Dans le passé, ces deux variétés (La Feuillée et Berrien) n’ont fourni, le plus souvent, que des moellons de médiocre qualité ; elles sont aujourd’hui délaissées. Sur sa bordure orientale, le granite de Berrien a été profondément transformé par des fluides hydrothermaux ; il a été longtemps exploité, jusqu’à une date toute récente, pour l’obtention de kaolin, dans une immense carrière ouverte au pied du Menez Molvé (en Grès armoricain) (infra).
Au sud, affleure un granite blanc-gris clair, à texture porphyroïde, constellé d’innombrables cristaux de cordiérite : c’est le granite du Huelgoat sensu stricto ; les exploitations pour pierres de taille étaient concentrées dans son secteur sud-est ; dans sa zone ouest, ce granite profondément arénisé était recherché comme « sable ». Sur son contact sud-est, le faciès Huelgoat sensu stricto fait place à des aplites sans biotite, riches en muscovite. À sa bordure méridionale, au lieu-dit Le Rest en Loqueffret, au sud du Menez Du, le granite est affecté par des émanations hydrothermales ayant entraîné la formation d’un important gisement de kaolin en cours d’exploitation, en contact, comme à Berrien avec le Grès armoricain (infra).
Dans sa partie centrale, le faciès Huelgoat sensu stricto fait place à un autre granite plus fin, bleu-grisâtre, parfois même assez sombre, où les feldspaths porphyroïdes et la cordiérite sont nettement moins abondants (« Bleu de Brennilis »). À Coat-Mocun, ce dernier granite est recoupé par un petit pointement de granite aplitique.
Menez-Molvé
A titre d’exemple, on décrit ici en détail le gîte du Menez-Molvé, exploité par la Société des Kaolins du Finistère, dont nous avons suivi régulièrement le développement (Chauris, 1984, 1988, 2019). L’immense carrière est ouverte à l’extrémité nord-est du pluton (fig. 6), au contact même des formations paléozoïques (schistes et quartzites ordoviciens) qui dessinent ici une structure périclinale en arc de cercle, à prolongement est (photo 3). La kaolinisation s’est principalement développée dans le faciès granitique dit de Berrien, à grandes muscovites, qui correspond à la partie la plus différenciée de la venue à biotite dite de La Feuillée. La différenciation se traduit par la superposition d’une paragenèse secondaire à albite-muscovite-quartz, à la paragenèse primaire à oligoclase-microcline-biotite-quartz, et par la décroissance des teneurs en Mg, Fe et Ca et l’augmentation de la teneur en Na.
Figure 6 - Esquisse géologique simplifiée de la carrière du Menez Molvé et de ses abords
D’après doc. Soc. Kaolins du Finistère et levers personnels
Photo 3 - Carrière de kaolin de Berrien, éclatante de blancheur
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 18 avril 1989
La kaolinisation en masse du granite de Berrien a été précédée par des processus plus localisés de greisenisation, tourmalinisation et séricitisation :
À proximité du contact de l’Ordovicien, des endogreisens s’alignent sur plusieurs dizaines de mètres, selon la direction d’ensemble N10-20°W. Ils se présentent en nodules pluridécimétriques, à texture zonaire : cœur formé de greisen hypermicacé (muscovite), passant à une écorce constituée de greisen quartzeux ; le processus s’achève par la formation d’amas de quartz. L’alignement des greisens selon une direction de faiblesse tectonique régionale (N 10-20°W) suggère que le déclenchement de la greisenisation est lié à une fracturation qui a permis la formation d’un premier système hydrothermal à température élevée (~ 450°-350° C). L’ampleur relativement restreinte de la greisenisation indique que l’ouverture de ce premier système a dû être de durée limitée.
À l’ouest du chapelet de greisens nodulaires, affleure selon la même direction (N 10-20° W), une large zone, en forme d’ellipse allongée, de granite altéré gris-verdâtre. L’analyse de la fraction « argileuse » indique une teneur élevée en K2O (7,40 %) due à la séricite et à l’hydromuscovite (?) ; la kaolinite est peu abondante.
Filonnets de quartz mylonitique aux épontes greisenisées. Ce type, exceptionnel, tant par sa texture que par son orientation, a été observé uniquement dans la partie méridionale de la carrière. Un filonnet, de 15 cm d’épaisseur, orienté WNW-ESE, à pendage 45° SSW, est bordé de greisen sur quelques centimètres, au sein du granite kaolinisé. Le quartz, laminé, en plages fusiformes à extinction roulante, admet des lentilles irrégulières très riches en tourmaline, en cristaux subautomorphes incurvés.
Filonnets de quartz minéralisé. À l’angle sud-est de la carrière, des filons de quartz à tourmaline renferment localement des amas pluricentimétriques d’arsénopyrite (assemblage de cristaux millimétriques), souvent en voie d’altération en scorodite, puis en limonite. L’examen en section polie de l’arsénopyrite montre, outre un peu de pyrite, de très fines inclusions de bismuth natif et, beaucoup plus rares, de bismuthinite ; à la scorodite s’associent digénite, covellite et des traces d’or natif (Chauris, 2014)5.
Tourmaline-quartz : Filonnets de quartz lenticulaires intragranitiques, sans continuité (l > 1 m, e = quelques cm), irréguliers, localement renflés. Ces tourmalinites-quartz sont souvent peu inclinées et rapprochées les unes des autres.
Filonnets de quartz gras, grisâtre, criblé d’aiguilles de tourmaline automorphes (<1mm x >2 cm), souvent démesurément allongées, non fracturées. Teinte vert-jaune sous la binoculaire.
Tourmaline dans l’auréole de contact des enclaves. Dans la carrière de kaolin de Berrien, les cristaux d’andalousite, rose violacé clair, développés dans les schistes au contact du granite, renferment de minuscules aiguilles de tourmaline verte. Des tourmalinites filoniennes massives, à grain fin, de puissance décimétrique, ont été observées en éboulis, à quelques centaines de mètres du granite près de Roc’h Illiec au nord-est de Berrien ; elles renferment des veinules de quartz irrégulières minéralisées en arsénopyrite.
Tourmalinisation dans l’écorce des greisens. Au Menez-Molvé, la tourmaline située à l’écorce des greisens va jusqu’à constituer de véritables tourmalinites. L’analyse chimique indique une teneur relativement élevée en MgO (3,04) par rapport à la teneur en Fe2O3 (5,87) ; la teneur en Li est très basse (57 ppm) : schorl à tendance dravitique6. En un mot, ces différentes paragenèses avec tourmaline représentent des émanations de fluides borés en dehors du magma à la faveur des fracturations tant du granite que de son encaissant. Ces fluides borés en se concentrant dans la tourmaline ont entraîné une déferrisation qui a « purifié » les zones kaolinisées en éliminant une grande partie du fer, élément « pénalisant » dans le kaolin.
Le granite kaolinisé s’étend sur au moins 800 m de long. La préservation des textures du granite et des filons aplitiques suggère que la kaolinisation a eu lieu sans changement de volume. Le quartz et la muscovite – tous deux intacts – se présentent dans une masse blanchâtre essentiellement constituée par de la kaolinite due à l’hydrolyse in situ des feldspaths. L’examen des résultats analytiques doit se faire en tenant compte de la différence de densité entre le granite sain et le granite kaolinisé (~ 2,60-2,00). Le calcul montre alors que la kaolinisation entraîne une forte diminution de la teneur en silice. La silice libérée lors de la kaolinisation précipite pour constituer des filons de quartz : les fissures ont joué à la fois le rôle de chenaux pour les fluides et de pièges pour la silice libérée. Les filons de quartz sont souvent abondants (filons subverticaux, d’orientation N 10-20°W, à remplissage symétrique avec quartz en peigne). Toutefois, le lien de ces filons avec la kaolinisation est complexe (présence de nombreux filons dans des zones peu ou pas kaolinisées ; rareté des filons dans des zones très kaolinisées). Ces modalités contradictoires suggèrent une migration importante de la silice dont l’origine (au sein des filons) serait alors, non pas proximale, mais distale.
Ainsi, un parallélisme, qui ne saurait être fortuit, apparaît entre la masse de granite kaolinisé et les produits de transformations antérieures ou sub-contemporaines. La direction N 10-20°W de ces néoformations correspond à une ligne de faiblesse tectonique d’importance régionale dont l’influence se fait sentir au-delà des limites d’affleurement du pluton. Par ailleurs, au contact du granite kaolinisé, les schistes ordoviciens sont également kaolinisés (perte de dureté, remplacement de la couleur bleu-noir par une teinte gris-beige ; chute des teneurs en Mg, Fe et surtout Ca). Cette altération peut se poursuivre localement jusqu’à 30 à 40 mètres du contact avec le granite ; elle est surtout intense dans les premiers mètres et décroît avec la distance, en même temps que diminue le pourcentage en kaolinite de la fraction fine. Il devient alors difficile d’attribuer la kaolinisation des schistes à un processus supergène, puisque leur altération augmente avec l’approche du granite kaolinisé, et non avec la proximité de la surface. Dans le même ordre d’idées, notons qu’à Berrien aucune zonalité d’origine climatique – de type tropical avec cuirasse latéritique – n’a été mise en évidence. Les seules actions supergènes observées dans le gisement sont dues à des remaniements superficiels aux dépens de formation en place : coulées de solifluxion (head), avec fragments de quartzites ordoviciens, qui masquent partiellement le gîte à l’est ; dépôt local (partie nord de la carrière) de kaolin de transport, superposé, sur quelques mètres, au granite kaolinisé in situ et dû à la solifluxion du kaolin primaire situé plus au sud. L’altération supergène (arénisation), souvent très intense dans le massif granitique du Huelgoat, n’est pas accompagnée de kaolinisation.
En un mot, le gisement de kaolin de Berrien s’est formé sous un toit de schistes et de quartzites ordoviciens qui a retenu une partie importante de fluides hydrothermaux. La voûte périclinale du Menez-Molvé, relativement imperméable, a fonctionné comme un piège structural qui a favorisé l’accumulation de fluides, surtout dans le granite, mais aussi localement, dans les premiers mètres de la couverture schisteuse où s’est développé un halo d’altération hydrothermale surimposé à l’auréole de métamorphisme (soulignée par la cristallisation de l’andalousite).
Menez-Du
L’occurrence a été découverte par l’équipe de M. Huiban, exploitant le gîte de Kerhouriou à Guiscriff, dans le batholite leucogranitique sud-armoricain.
Le gisement a environ un kilomètre de longueur sur une largeur de 150 à 200 mètres ; sa profondeur est localement, au moins de 60 mètres (photo 1). La teneur en kaolinite est de l’ordre de 32-33 %. Comme le gisement de Berrien, le gîte de Loqueffret (dit aussi du Rest) est situé au contact de l’Ordovicien inférieur, au pied du Menez-Du qui ici, aussi, a joué un rôle préservateur vis-à-vis de l’érosion. Les filonnets tourmalinisés sont très nombreux dans le granite kaolinisé et, localement, dans le toit gréseux.
Dans l’exploitation du Rest, le granite kaolinisé est recoupé par des filonnets de tourmalinite massive, de 5-6 cm d’épaisseur, présentant deux faciès totalement différents (photo 4). La plus grande partie de ces filonnets est constituée par une tourmaline noire, en cristaux cannelés, parfois légèrement incurvés ou fracturés perpendiculairement à leur allongement, orientés dans toutes les directions, avec localement tendance à la texture en éventail ; les cristaux, de quelques millimètres de long sur une largeur millimétrique, ne laissent place à aucun autre minéral. Cette masse noire, brillante, est parcourue par des filets de 1-2 mm à 1 cm de puissance, de teinte vert foncé, se ramifiant dans le sens de l’allongement ; la présence d’innombrables fragments inframillimétriques de la tourmaline encaissante indique une cataclase postérieure ayant entraîné la formation d’une micro-brèche de tourmalinite.
Photo 4 - Tourmalinite massive recoupant le granite kaolinisé de Loqueffret (L = 9,5 cm)
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 21 mars 2012
Le granite kaolinisé est aussi recoupé par des filonnets pluricentimétriques, de quartz grisâtre, à éclat gras, extrêmement riches en aiguilles de tourmaline noire, cannelées, d’allongement centimétrique, diversement orientées avec parfois une légère tendance à la texture « en soleil ». Ces aiguilles sont moulées par le quartz qui en colmate aussi les fissures (photo 5).
Photo 5 - Filonnet de quartz à tourmaline recoupant le granite kaolinisé de Loqueffret (L = 8 cm)
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 21 mars 2012
Au contact du granite kaolinisé, le Grès armoricain, blanchâtre, à grain extrêmement fin, est recoupé par des veinules infra-centimétriques de quartz à éclat gras, avec dissémination de tourmaline noire, en cristaux cannelés. Sur l’une des épontes, la tourmaline forme un placage millimétrique pratiquement continu, du type « filon-diaclase » ; parfois, elle ne constitue plus que des « soleils » de quelques centimètres de diamètre. Dans l’autre éponte, elle s’insinue dans le grès en filets infra-millimétriques.
Autres occurrences
Nous avions examiné, en 1976, à la faveur de travaux routiers, un petit indice, dépourvu d’importance économique – tout au moins le long de la coupe relevée – mais fort instructif au point de vue géologique, au nord de Roz an Hoël en La Feuillée, à la bordure septentrionale du pluton (fig. 7). Des affleurements discontinus montraient, du sud au nord :
- le granite arénisé, grossier, à deux micas ;
- le granite kaolinisé, à grain grossier, avec muscovite (épaisseur imprécisée) ;
- le Grès armoricain (Ordovicien inférieur), très fortement altéré (aspect sableux) près du granite kaolinisé (halo d’altération hydrothermale ?) ;
- le Grès armoricain fortement laminé selon la direction ENE-WSW (influence de la faille méridionale des Monts d’Arrée) ;
- le Grès en bancs réguliers, passant vers le haut à une alternance de grès et de schistes ;
- un niveau rougeâtre, minéralisé en rutile et zircon, nettement radioactif. Les deux derniers ensembles sont recoupés par quelques filons peu inclinés d’aplite kaolinisée. L’examen de cette coupe entraîne plusieurs remarques : localisation de la kaolinisation à la bordure du pluton, juste sous le toit de Grès armoricain (granite) ou dans le grès lui-même (filons aplitiques) ; halo d’altération hydrothermale possible, de plusieurs mètres, dans le Grès armoricain ; absence (en ce point) de filon quartzeux ; altération « pervasive » du granite et des aplites ; rôle protecteur de l’érosion joué encore ici par la barre de Grès armoricain.
Du kaolin a été également détecté près du lieu-dit Forc’han, ainsi qu’à proximité de la centrale nucléaire de Brennilis (désaffectée), site actuellement inaccessible par suite des risques de contamination.
Au total, les différentes occurrences, liées au granite du Huelgoat (au moins cinq!) sont situées à la bordure du pluton, ce qui ne saurait être fortuit.
Quintin - Moncontour - Dinan
Quintin
Le massif polyphasé de Quintin présente d’assez nombreux indices de kaolin, encore mal connus, associés à des filons de quartz tardifs transversaux, sans liaison avec une venue granitique particulière. Citons ici Keroncel près de Locarn ; Roc’h Pen Darben au NW de Saint-Gilles-Pligeaux ; et surtout plusieurs indices à l’ouest du Foeil (dans l’endogranite du Leslay). Dans ce dernier district, les filons quartzeux montrent une coïncidence spatiale assez lâche avec la zone de faiblesse précoce Canihuel-Boquého d’une part, et avec la fracturation tardive à laquelle sont liées les minéralisations stanno-wolframifères d’autre part. Ils témoignent ainsi de la pérennité des mêmes zones de faiblesse transverses tout au long de l’évolution du pluton polyphasé.
Moncontour
Plusieurs indices ont été signalés par B. Mulot (1971). Bois-Hardi, au sud de Bréhand, avec travaux de reconnaissance en 1964 ; Quengo, à l’ESE de Plémy, sondé en 1957 ; Bel-Orient, à l’extrémité ouest du massif près de l’Hermitage-Lorge. A ce sujet, rappelons que Y. Milon (1936) avait déjà indiqué quelques gisements à Ploeuc non loin de la gare. On remarquera que dans le massif de Moncontour, les occurrences de kaolin ont une nette tendance à se situer vers la bordure du pluton (et qu’il en est de même pour les gîtes d’uranium).
Dinan
La présence d’argile kaolinique a été observée depuis longtemps dans la région de Dinan. Un toponyme « La Poterie » est connu au nord de Languédias, mais on ignore d’où provenait la matière première. La fabrique de poteries signalée par E. de Fourcy (1844) à Dinan, était alimentée par une « argile... très blanche et très fine » extraite de la Lande du Tournet, bien au-delà des limites du pluton. Ainsi, le lien entre « poteries » et « gisements » peut-il être très lâche… Selon P. de Brun (1911), le kaolin a été exploité à Jugon et à Trélivan. B. Mulot (1971) indique que des sondages pour la recherche du kaolin ont été exécutés en 1949 et en 1965 au lieu-dit le Bois de la Lande du Parc au nord de Quévert, c’est-à-dire au nord du massif granitique. Il serait intéressant de savoir s’il existe effectivement en ce point une réapparition du pluton présumé caché en profondeur ; l’indice paraît en relation avec des filons de quartz. Par ailleurs, toujours selon B. Mulot, des exploitations d’argile (de nature imprécisée) ont eu lieu vers les années 1930 un peu au sud du site précité.
Toutefois, les occurrences de kaolin les plus importantes sont en relation avec le grand filon quartzeux de Trélivan qui recoupe de part en part le massif de Dinan selon la direction N 20° W. Le gîte, dénommé parfois Vaucouleurs est connu sur une extension longitudinale d’environ 2,5 km et est jalonné par de petites extractions datant des années 1930 (Mulot, 1971). Des sondages en vue de sa reconnaissance en profondeur ont eu lieu en 1965. Plus récemment, l’occurrence a été traversée par les travaux de dédoublement de la route N 176 qui ont mis en évidence un granite kaolinisé de teinte blanche, au toucher gras, recoupé par des filons de quartz grisâtre. Le passage de la zone filonienne quartzeuse détermine un relief dans la topographie : le gisement appartient par suite à la catégorie des kaolins de crête. La liaison spatiale avec le filon quartzeux prouve, à l’évidence, l’origine hydrothermale de la kaolinisation.
Axe silicifié Mousteru - Saint-Julien
Sur la première édition de la feuille Saint-Brieuc à 1 : 80 000, Ch. Barrois (1896) a figuré sous le nom de « quartzites cristallins » une longue et étroite bande de roches siliceuses rapportées au Grès armoricain. Sur la deuxième édition de la même feuille, P. Pruvost et G. Waterlot (1941) précisent le tracé de cette bande , à laquelle ils rattachent, à juste titre, une formation comparable située plus à l’est, près de Saint-Julien ; les roches sont rapportées aux grès du Dévonien inférieur.
Cette formation siliceuse s’étend entre le sud de Mousteru et le NE de Saint-Julien, sous forme de plusieurs tronçons discontinus ; ses deux extrémités sont distantes d’environ 35 km ; sa direction générale est N 100 à 110°E ; sa puissance atteint plusieurs dizaines de mètres. Elle est encaissée sur la plus grande partie de son tracé dans un complexe cristallophyllien, fortement mylonitisé selon la même direction. Les carrières ouvertes dans cette formation pour l’empierrement des routes montrent des roches essentiellement siliceuses, le plus souvent à grain très fin, dures, blanc-gris à rougeâtre, offrant une nette structure bréchique, à ciment parfois ferrugineux. Les roches siliceuses, puissantes et massives dans la partie centrale des carrières, se résolvent à la bordure des exploitations, en une série de filonnets.
Nulle part n’ont pu être mises en évidence des structures de grès sédimentaires ou de quartzites métamorphiques. Les examens sur le terrain et au laboratoire indiquent, à l’évidence, qu’il s’agit de roches silicifiées d’origine hydrothermale, interprétation appuyée par la kaolinisation associée (carrière du Bois-Meur, à l’est de la cote 262 ; Saint-Péver ; sud de Mousteru…). Les zones kaoliniques sont parcourues par d’innombrables filonnets de quartz ; parfois, la kaolinisation n’est pas totale : des reliques plus ou moins transformées de l’encaissant sont encore reconnaissables. Souvent, le kaolin est disséminé sous forme de petits amas, inclus dans la masse même de la roche silicifiée. Près de Saint-Julien, le nom d’un village (La Poterie) situé à proximité de la bande siliceuse, suggère l’existence d’une ancienne exploitation. Entre Saint-Adrien et Saint-Pever, aux abords de la profonde vallée du Trieux, les eaux de source sont parfois blanchies par le kaolin.
Au total, les roches siliceuses Mousteru-Saint-Julien dérivent de processus de silicification hydrothermale, développés à la faveur d’une importante zone de faiblesse tectonique. La kaolinisation hydrothermale qui accompagne cette silicification s’est ainsi formée le long d’un accident très allongé, contribuant à l’individualisation d’un type de gîte linéaire assez particulier (Chauris, 1970).
Il est possible que certaines occurrences argileuses connues à l’est de Saint-Julien en direction de Lamballe soient à mettre en relation avec le prolongement présumé de cet accident majeur : la reconnaissance de ce secteur sera l’un des buts de nos prochaines investigations…
Conclusions
Au terme de cette analyse sur les occurrences de kaolin d’origine endogène reconnues à ce jour dans le batholite hercynien médio-armoricain et ses abords, replacées dans l’ensemble des gisements en Bretagne, plusieurs conclusions s’imposent.
La première place occupée depuis longtemps par l’ouest de la France dans la production du kaolin d’origine hydrothermale devrait se maintenir, mieux, sa part pourrait même augmenter, au vu des gisements importants non encore exploités (dans le district de Ploemeur, à La Villefoucré, à Lannéanou…) et des potentialités offertes par des districts aujourd’hui à peine révélés par quelques indices.
Parmi les métallotectes favorables à la formation des gisements hydrothermaux de kaolin, le premier est en relation directe avec la fracturation permettant la circulation des fluides d’origine profonde. Les exemples présentés dans cet article sont trop nombreux pour être repris ici. On notera seulement que la fracturation doit se maintenir pendant un grand laps de temps pour permettre l’activité prolongée des circuits convectifs. En effet, par suite de son extension, la kaolinisation exige la coïncidence et la persistance de conditions structurales et thermiques particulières : fissuration et perméabilité élevées pour faciliter l’importante circulation hydrothermale des fluides ; fort gradient thermique pour conduire efficacement la convection hydrothermale. La migration de ces conditions au cours de la durée de vie du système hydrothermal, à la faveur de structures linéaires (zone de faiblesse tectonique d’ampleur régionale), peut faciliter l’extension de l’altération.
La kaolinisation correspond à l’étape ultime de la déstabilisation des massifs granitiques et tout particulièrement des leucogranites (type Ploemeur). Toutefois, des circulations hydrothermales peuvent se produire également dans d’autres circonstances, indépendantes des processus post-magmatiques, par exemple le long de linéaments. L’exemple des occurrences apparaissant à la faveur du grand accident Mousteru-Saint-Pever est démonstratif à cet égard. De même, dans la région de Plémet, la kaolinisation est manifestement en rapport avec une zone failleuse transverse qui affecte aussi bien les diorites quartziques (Le Pas) que le granite à deux micas (Kerouët) et même les schistes (Fahéleau).
Au vu de la balance géochimique, le quartz filonien qui accompagne les gisements dérive, en partie au moins, de la transformation des feldspaths en kaolinite. La silicification n’est pas alors la cause de la kaolinisation, mais la conséquence.
Dans plusieurs cas, l’action des fluides hydrothermaux de température relativement modérée entraînant la kaolinisation a été précédée par des fluides de type pneumatolitique ou hydrothermaux de température élevée ayant conduit, localement, à la greisenisation, à la tourmalinisation, à la séritisation . Le cas du gîte de Berrien est exemplaire à ce sujet. L’étude des inclusions fluides – que nous n’avons pas personnellement entreprise – permet de préciser les températures de formation. On se reportera ici aux travaux de Nicolas (1957 a et b, 1958) et de Charoy (1975).
La roche-mère a joué un grand rôle dans la qualité du matériau argileux de néoformation. Les granites riches en muscovite (type Ploemeur) apparaissent les plus favorables. Leur intérêt est encore accru par le fait que la muscovite est aujourd’hui un co-produit très estimé. Au contraire, dans le district de Landivisiau, la kaolinisation s’est effectuée essentiellement aux dépens des granitoïdes à biotite (granodiorite, granite) (Chauris et Garreau, 1988). Cette souche, relativement riche en fer et en magnésium, rend compte des caractéristiques chimiques des kaolins : malgré l’intensité de la métasomatose, ces éléments n’ont été, dans de nombreux cas, que partiellement éliminés. Le cas de l’altération à partir des schistes est également beaucoup moins favorable (pourcentage plus ou moins élevé en séricite associée à la kaolinite…).
Les formations encaissantes peuvent aussi influencer le processus de kaolinisation en fournissant des pièges plus ou moins étanches : les cas de Berrien et de Loqueffret sont très instructifs à cet égard.
La superposition de ces différents facteurs a conditionné la morphologie très variée des gisements : gîtes en amas ; gîtes allongés, kaolin de cuvette, kaolin de crête… Dans l’interprétation hydrothermale présentée ici, il ressort que plusieurs gisements sont encore masqués en profondeur ou à peine affleurants. Le cas d’une des occurrences de Piriac est une éloquente démonstration de cette manière de voir.