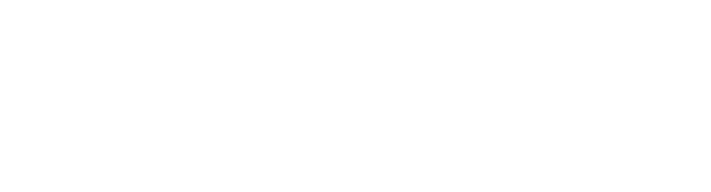« Il n’est pas nécessaire d’épuiser un sujet, il suffit de faire penser ». Montesquieu
Plusieurs articles ont été publiés récemment par l’auteur (Chauris, 1997a, 1997b, 2008, 2014, 2016a, 2016b, 2018, 2020) sur la diversité des pierres utilisées pour la construction des ouvrages d’art (ponts et viaducs) lors de l’établissement des chemins de fer en Bretagne. Dans le présent mémoire, l’attention est portée, à son tour, sur d’autres infrastructures liées aux voies ferrées, dans la même région, à savoir les gares, les haltes et les gardes-barrières qui, elles aussi, ont nécessité l’appel à de nombreuses roches tant en pierres de taille qu’en moellons, voire en briques.
Rappelons tout d’abord que les voies ferrées, en Bretagne, peuvent être regroupées en plusieurs ensembles différents (fig. 1) :
-
Les grandes lignes au départ de Paris, tant au nord, via Rennes jusqu’à Brest, qu’au sud, via Nantes, jusqu’à Quimper.
-
Les lignes de raccordement entre ces deux axes, à l’est Rennes-Redon ; à l’ouest Quimper-Landerneau.
-
Ce réseau majeur a été complété par des voies de raccordement à diverses cités littorales, tant au nord (Saint-Malo ; Paimpol ; Lannion ; Roscoff) qu’au sud (Saint-Nazaire, La Baule, Le Croisic ; Quiberon ; Concarneau ; Douarnenez).
-
Enfin, plusieurs lignes à voie étroite ont complété le maillage, entre autres, la voie nord-sud Morlaix-Carhaix-Rosporden ; la ligne Loudéac-Châteaulin et Châteaulin-Crozon-Camaret ; d’autres petites voies, encore, non envisagées ici.
Plusieurs groupes s’étaient partagé les marchés. Ainsi, pour les grandes lignes est-ouest : « Ouest », « Orléans », avant d’être regroupées par la SNCF, créée en 1938.
Par ailleurs, plusieurs gares ont été entièrement reconstruites. Tel est le cas de la gare de Saint-Brieuc (1931), de Brest (1936), de Landerneau (1991). La gare d’Escoublac-La Baule a été édifiée tardivement (1927).
Nos recherches ont porté non seulement sur les bâtiments eux-mêmes, mais aussi, éventuellement, sur les dallages mis en place à leurs abords, ainsi que sur quelques monuments commémoratifs érigés ultérieurement. Nos annotations sont fondées essentiellement sur des observations, in situ, effectuées sur les bâtiments eux-mêmes – à ce sujet, qu’il nous soit permis de remercier les chefs de gare pour leur compréhension – éventuellement complétées par des documents archivistiques et bibliographiques.
Plusieurs ouvrages font écho à la construction des gares du chemin de fer en Bretagne (Saurel, 1981 ; Henwood et al., 1996 ; Sanquer et al., 2001 ; Nennig, 2010 ; Lamming, 2020), mais leur dépouillement, sauf exception, n’apporte guère de renseignements sur la nature et encore moins la provenance des pierres mises en œuvre. Ainsi se manifeste clairement l’intérêt de ce mémoire destiné à combler cette lacune.
Le présent article est toutefois très loin d’avoir la prétention d’être exhaustif : vu l’ampleur du sujet, un fort volume aurait été nécessaire ! Plus simplement, il s’avère être, en quelque sorte, une invitation pressante aux voyages, tantôt par « Le Rapide » avec ses rares arrêts, tantôt par « l’Omnibus » ponctués de « descentes ». Dans quelques cas, les différentes pierres mises en œuvre sont envisagées ; plus souvent, l’accent mis seulement sur telle ou telle roche. En fait, tout bien considéré, les gares apparaissent comme des ports, avec une terminologie identique : quai, embarquement… Elles sont, selon les cas, voire les deux à la fois, témoignages de l’émanation du terroir avec emploi des pierres proximales, ou ouverture au loin avec recherche des pierres distales, en un mot, d’ici et d’ailleurs ; mieux, les examiner est, à la fois, voyager dans l’espace et le temps. Ces investigations encore préliminaires apparaissent comme le chuchotement des pierres tant des gares que des haltes, voire des gardes-barrières, traversées par le train : « Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, ton glissement nocturne » (V. Larbaud).
Ligne Rennes-Brest
Rennes
La gare de la capitale bretonne a été inaugurée en 1857… Le T.G.V. l’atteint en 1988, plus de cent ans après. Bombardée pendant la guerre, elle a vu ses infrastructures profondément remaniées. Les aménagements récents ont mis en œuvre, en placages, un gabbro de teinte sombre, extrait semble-t-il, en Afrique du Sud (Zimbabwe), signant, avec l’abandon des particularismes locaux, l’ouverture au monde. Érigée à proximité de la gare SNCF, la gare routière a recherché un granite mancellien (nord-est du Massif armoricain), en placages polis, avec nombreuses enclaves (« crapauds » des carriers). Facilement identifiable, même de loin, par ses innombrables cristaux à section rectangulaire, gris sombre, de cordiérite (et son habitus porphyroïde), le granite du Huelgoat (Finistère) a été récemment utilisé pour l’entrée du métro devant la gare.
Lamballe
Les trois assises, en pierre de taille, du soubassement de la gare sont en granite porphyroïde de Moncontour qui affleure à quelques kilomètres seulement au sud de la ville.
Saint-Brieuc
La « nouvelle » gare inaugurée en 1931 (supra) a fait une large utilisation du granite à grain fin, gris clair à beige, de Languédias (dans le massif de Dinan, Côtes-d’Armor). Toutefois, les deux assises du soubassement sont en pierres locales (granite de Saint-Brieuc). Les dallages intérieurs, au sol, récents, sont en granite à cordiérite du Huelgoat ; de même, la partie inférieure des murs intérieurs.
Guingamp
La partie inférieure du bâtiment est en granodiorite porphyroïde de Bégard (massif de Plouaret).
Plouaret
Exécutée initialement pour la ligne Rennes-Brest, à proximité d’une profonde et longue tranchée, la gare de Plouaret a été ultérieurement le point de départ de la ligne en direction de Lannion. Le soubassement de la gare a fait appel à deux faciès différents du massif de Plouaret : un granite à grain fin pour l’assise basale ; un granite porphyroïde pour les trois assises supérieures. Au-dessus de l’entrée, le nom est indiqué en français et en breton.
La place de la gare a été récemment réaménagée. À son angle est, a été élevé un monument constitué par deux éléments monolithes juxtaposés, en granite à grain moyen extrait, semble-t-il, d’une des carrières ouvertes dans le massif de Guéhenno en Morbihan. Cet édicule commémore deux « batailles du rail » : la première relative aux actions menées contre l’occupant lors de la dernière guerre ; la seconde, quelque peu inattendue, rappelle les luttes menées pour obtenir l’arrêt du TGV à Plouaret. Dallages et bordures des plantations ont été façonnés dans un granite rougeâtre, à gros grain, en provenance, semble-t-il, du massif de Ploumanac’h dans les Côtes-d’Armor.
Morlaix
Les archives départementales du Finistère (ADF 5 S 34) rappellent que, par arrêté préfectoral du 7 novembre 1861, les sieurs Le Breton, Magniet et Monghéal sont entrepreneurs de la gare de Morlaix (marchés le 23 août 1861, avec un rabais de 11%). La station est située sur les hauteurs de la ville, au-delà de l’église Saint-Martin, entre la sortie occidentale du célèbre viaduc et une profonde et longue tranchée, témoins irréfutables du relief de la Basse-Bretagne ayant nécessité d’impressionnantes infrastructures. Le soubassement de la gare fournit un excellent exemple de l’utilisation simultanée de divers granites (polylithisme) du district de l’Île Grande dans les Côtes-d’Armor. Devant la gare, aménagement en granite de Languédias (Côtes-d’Armor). En sus de l’ancien passage souterrain, une élégante passerelle, avec ascenseurs, franchit à présent les voies ferrées.
Entre Morlaix et Landivisiau
- Près de Morlaix, la maison gardes-barrières (P.N. 275) au sud-ouest de Kerivin en Saint-Martin-des-Champs, a mis en œuvre le faciès rose de l’Île Grande pour le soubassement et les pierres d’angle.
- À Treillic (sud-est de Guimiliau), les pierres d’angle de la maison gardes-barrières ont fait appel au kersanton de la rade de Brest, exemple d’un impact, sur la voie ferrée, à distance du site d’extraction.
- À Landivisiau, la partie est (probablement plus récente) présente un soubassement en granite porphyroïde à cordiérite du Huelgoat ; plus vers l’ouest, une porte en granite porphyroïde avec un peu de muscovite (granite de Cléder?) ; le reste de l’édifice, plus élevé, est en granite fin à muscovite, de provenance imprécisée, avec, au-dessus, encadrement des ouvertures et chaînages d’angle en briques.
De Landerneau à Brest (fig. 2)
Figure 2 - Lignes Quimper-Landerneau et Morlaix-Brest
Emploi du kersanton : exemple de mise en œuvre relativement proximale.
La gare de Landerneau, avec son bâtiment central, couronné par une horloge monumentale, et ses ailes latérales où la brique jouait un rôle majeur (chaînages d’angles et encadrements des ouvertures), sauf dans les assises en pierres de taille du soubassement, a été entièrement détruite, en 1991, malgré l’opposition de quelques nostalgiques du passé… La pierre a presque entièrement disparu ; seul peut-on déceler sous la tablette des quais, des pierres de taille à présent impossibles à identifier lithologiquement. La façade méridionale, donnant sur la place, toute en verre encadré d’acier, reflète l’aspect changeant des ciels bretons (photo 1)... Latéralement, bâtiment en aggloméré. Le sol intérieur du hall est un dallage artificiel, la voûte avec soutènement métallique. Un passage aérien avec ascenseurs permet, comme à Morlaix, la traversée des voies ; le passage souterrain a toutefois été conservé (avec placages verticaux de petits carrelages). En un mot, la gare de Landerneau a subi, à la fin du XXe siècle, une étonnante métamorphose où le verre et l’acier ont succédé à la pierre...
Photo 1 - Gare de Landerneau
Façade en verre sur la place, reflétant le ciel changeant.
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 15 mars 2022
Le soubassement d’une maison de gardes-barrières à l’ouest de Landerneau est en gneiss de Brest.
À La Forest-Landerneau, le plus grand bâtiment de la station présente des encadrements d’ouvertures en granite à grain fin, à muscovite, en provenance très probable du massif de Saint-Renan – Kersaint qui affleure un peu plus au nord. Dans le bâtiment plus petit, à l’ouest, encadrement en granite porphyroïde blanchâtre probablement du même massif.
La gare de Kerhuon est située à faible distance du grand viaduc enjambant l’anse de ce nom. Le soubassement est formé par quatre assises en pierres de taille façonnées dans le granite porphyroïde à feldspaths roses de l’Aber-Ildut (fig. 3). Les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures sont en briques rouges, qui, localement altérées, ont été peintes (photo 2) !
Figure 3 - Emploi des granites du massif de l’Aber-Ildut. Exemple de mise en œuvre relativement distale
La ligne à voie étroite Châteaulin-Camaret n’a pas été figurée.
Photo 2 - Gare de Kerhuon
Assises basales en granite de l’Aber-Ildut. Chaînages d’angle et encadrement des des ouvertures en briques rouges
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 23 mars 2022
Brest
Les archives départementales du Finistère (ADF 5 S 34) précisent (le 17/11/1863) que les Sieurs Hurebelle, frères, sont entrepreneurs de la gare de Brest. L’inauguration de la ligne Guingamp-Brest avait lieu le 25 avril 1865. Le bâtiment central avec horloge et fronton triangulaire était flanqué de deux bâtiments latéraux, devant une large esplanade. Un rapport de l’ingénieur ordinaire, en date du 28 mars 1862 (Arch. départ. Finistère 5 S 37) indique la mise en œuvre d’un granite extrait à Brélès dans le massif de l’Aber-Ildut (sans que le faciès soit précisé).
Une nouvelle gare était édifiée en 1936, dans le style « Art Déco », sur les plans d’U. Cassan avec dôme coupoliforme et campanile latéral, le tout faisant un large appel au béton (photo 3). L’ensemble a partiellement survécu à la guerre. Sur le campanile, imposante sculpture en méplat dans le granite rouge de Ploumanac’h (Côtes-d’Armor) due à L. Brasseur, dont seule subsiste la partie inférieure. Au sol, sous la coupole, beau dallage en grands éléments de calcaire marbre (photo 4). Au pied de l’élévation intérieure de la coupole, plaques verticales en marbre calcaire, vivement coloré, tous de provenance lointaine imprécisée. Une plaque en granite de La Clarté (Ploumanac’h) a été apposée verticalement à la mémoire des cheminots tués par faits de guerre (photo 5).
Photo 3 - Gare de Brest
Edifiée en 1936 en remplacement de la gare initiale qui faisait appel au granite, elle utilise largement le béton.
Crédits photos : Louis et Marie Madeleine Chauris, 11 novembre 2021
Photo 4 - Placage vertical en calcaire marbre dans le hall de la gare de Brest
Crédits photos : Louis et Marie Madeleine Chauris, 11 novembre 2021
Photo 5 - Plaque verticale en granite rouge de La Clarté (Ploumanac’h) à la mémoire des cheminots tués par faits de guerre (gare de Brest)
Crédits photos : Louis et Marie Madeleine Chauris, 11 novembre 2021
Les dallages extérieurs aux abords de la gare, mis en place assez récemment, ont fait appel à plusieurs beaux granites bretons : granite rouge de Ploumanac’h (carrière de La Clarté, Côtes-d’Armor) ; granite bleu de Lanhélin (Ille-et-Vilaine), granite dit « Gris Celtique » en provenance de la carrière de Kergontrary en Plounevez-Quintin (Côtes-d’Armor), facilement identifiable par ses gros feldspaths blanchâtres. La limite du stationnement des voitures est soulignée par des pavés de récupération en microgranite de l’Île Longue.
Ligne Nantes-Quimper
La ligne atteint Nantes en 1851 et Quimper en 1863. Seules quelques annotations lithologiques sont présentées succinctement sur ce tronçon.
Nantes
Le répertoire de 1889 (Paris, 1890) précise que les carrières de Saumoussay-Saint-Cyr exploitant une masse de tuffeau dans le Saumurois (craie blanche, très fine, de densité 1,33) ont fourni des pierres pour la gare de Nantes. Le même répertoire signale aussi la mise en œuvre du schiste bleu de Nozay.
Redon
Le soubassement de la gare est en pierres de taille façonnées dans le granite d’Allaire, caractérisé par ses longs cristaux feldspathiques blanchâtres, extrait à quelques kilomètres à l’ouest de la cité. Au-dessus, tuffeau pour encadrements des ouvertures et chaînages d’angle. Élévation en briques.
Vannes
Le soubassement est formé par plusieurs assises en pierres de taille, façonnées dans un granite à grain fin, à muscovite, extrait, semble-t-il, dans le massif de Belz-Crac’h. Comme de nombreuses gares de la Compagnie d’Orléans, celle de Vannes a fait un large appel au tuffeau, ultérieurement peint en blanc. Encadrement des ouvertures en briques rouges.
Auray
Atelier avec alternance de tuffeau et briques.
Hennebont
Seules les assises du soubassement sont visibles. Pierres de taille en granite à gros grain, à tendance porphyroïde, blanc-gris, à biotite, de provenance imprécisée.
Lorient
Selon toute probabilité, les anciens bâtiments avaient mis en œuvre le tuffeau et la brique. Lors de la reconstruction, appel au schiste rouge du Paléozoïque inférieur, du « Pays pourpre » en Bretagne centrale, livrant des moellons plats.
Quimperlé
La partie inférieure de la gare est en granite de Trégunc ; le reste est blanchi, masquant la pierre. Les contreforts d’un entrepôt présentent une alternance tuffeau-brique (photo 6).
Photo 6 - Un des bâtiments de la gare de Quimperlé : alternance brique rouge et tuffeau blanc altéré
Crédits photos : Louis et Marie Madeleine Chauris
Rosporden
Les ateliers présentent l’association brique-tuffeau altéré.
Quimper
Si pour le soubassement de la gare, la Compagnie des chemins de fer d’Orléans a mis en œuvre le granite local, en pierre de taille, appel a été fait, pour les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures, au tuffeau du Val de Loire, les élévations étant en brique rouge. Comme partout, sous les impacts du climat océanique, le tuffeau s’altère peu à peu par desquamation, voire effritement, tandis que le granite, emplacé à la même date, semble défier les siècles (photo 7).
Photo 7 – Gare de Quimper
Soubassement en granite local, chaînages d’angle et encadrements des ouvertures en tuffeau du Val de Loire, élévations brique rouge.
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 19 mai 2010
Après le dernier conflit, a été adossée au bâtiment, côté quai, une grande plaque verticale, en granite rose-rougeâtre, de Ploumanac’h dans les Côtes-d’Armor, à la mémoire des cheminots morts par faits de guerre ; un bac à fleurs est façonné dans la même pierre.
Dans la maison gardes-barrières, rue de Brest, on perçoit, sous la peinture, également tuffeau et brique.
Ligne Quimper-Landerneau (fig. 2)
Pont-Quéau
La halte joue aussi le rôle de passage à niveau. Les pierres d’angle offrent une alternance tuffeau-brique.
Quéménéven
Le soubassement est constitué par quatre assises en moellons de leucogranite grossier, riche en muscovite, en provenance possible du massif de Pontivy (Morbihan). Encadrements des portes et fenêtres en tuffeau très altéré.
Châteaulin
Le soubassement du bâtiment daté de 1864 est constitué par quelques assises leucogranitiques bien façonnées, en provenance, comme on pouvait s’y attendre, du massif proximal de Locronan. Au-dessus, les encadrements des ouvertures sont formés par une alternance de briques rouges et de tuffeau du Val de Loire, utilisés aussi pour les pierres d’angle.
Saint-Ségal
Assises du soubassement en granite du Huelgoat constellé de cristaux de cordiérite (02/11/2015).
Pont-de-Buis
L’ancien bâtiment de la gare a fait appel pour les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures au kersanton gris des confins orientaux de la rade de Brest, relativement proximal.
Hanvec
La partie inférieure de la gare est constituée par quatre rangées de moellons en kersanton gris, puis par un bandeau de pierres de taille façonnées dans la même roche. Les pierres d’angle sont en tuffeau, de même les encadrements des ouvertures. Les murs montrent une alternance brique-tuffeau.
Dirinon
La zone basse du bâtiment a fait appel au granite porphyroïde rose de l’Aber-Ildut ; ailleurs, alternance brique-tuffeau.
(La gare de Landerneau a été présentée dans le chapitre Rennes-Brest).
Ligne Guingamp-Paimpol
Longue de 36 km, la ligne, à voie métrique, est ouverte en 1894, puis ultérieurement, en 1924, mise à voie normale. Elle présente deux beaux ouvrages d’art : viaduc de Pontrieux sur le Trieux, viaduc de Fry an Dour sur le Leff.
(La gare de Guingamp a été présentée dans le chapitre sur la ligne Rennes-Brest).
Trégonneau-Squiffiec
Le soubassement de la gare a mis en œuvre la granodiorite de Bégard, bien caractérisée par ses gros feldspaths trapus. La bordure du quai de chargement est en la même roche façonnée en très belles pierres de taille.
Brélidy-Plouëc
Soubassement en granodiorite de Bégard. Chaînages d’angle et encadrements des ouvertures en briques rouges (03/08/1997).
Halte de Pontrieux
Briques claires et béton.
Pontrieux
Soubassement de la gare en granite à grain fin du district de l’Île Grande (quatre assises au pignon), puis briques rouges. Superbe pierre du hangar de chargement (230 x 47 x 20 cm) en granodiorite de Bégard. Moellons du soubassement du hangar en grès rouge lie-de-vin de Plourivo. Briques rouges des chaînes d’angle et encadrements des ouvertures de la gare. Soubassement des tablettes en granite gris de l’Île Grande.
Lancerf
Le soubassement de la gare et la bordure du quai sont en granite gris du district de l’Île Grande, la base du quai étant en grès rouge. La bordure du quai est en granite blanc à muscovite de l’Île Grande.
Paimpol
Côté quai, la gare présente quatre assises en granite blanc du district de l’Île Grande, surmontant une assise basale chanfreinée en granite rose (faciès Agathon) du même district. La tablette du quai voyageurs est, au moins en partie, en leucogranite de l’Île Grande ; la tablette du quai des marchandises en granite gris de l’Île Grande, avec une marche en granodiorite de Bégard.
Ligne Plouaret-Lannion
Les travaux d’exécution de la ligne ont été effectués en 1880-1881. Le tracé s’étire sur 17 km, descendant de Plouaret (123 mètres) à Lannion (7 mètres). En sus des gares de Plouaret et de Lannion, une seule station, la halte de Kerauzern (avec passage à niveau) est aujourd’hui fermée.
(La gare de Plouaret a été présentée dans le chapitre consacré à la ligne Rennes-Brest).
La halte de Kerauzern avait fait appel à de médiocres moellons en provenance de divers faciès du vaste massif granitique de Plouaret ; marche d’accès en granodiorite de Ploubezre dans le même massif. Encadrements des ouvertures en briques rouges.
La gare de Lannion a été entièrement reconstruite. L’assise basale de l’ancien bâtiment, en pierres de taille, avait fait appel au granite gris, avec un peu de muscovite, du district de l’Île Grande. Le nouveau bâtiment qui contient aussi la gare routière a totalement délaissé la pierre.
Ligne Morlaix-Roscoff (fig. 4)
La construction de la ligne, à voie unique (28 km), a été exécutée entre 1880 et 1883. La voie se détache du tracé Rennes-Brest à 2,6 km de Morlaix. La profonde ria de la Penzé est franchie par un élégant viaduc à piles granitiques et tablier métallique. Cinq stations sont édifiées entre Morlaix et Roscoff. Le grand nombre de passages à niveau (25), avec maisons gardes-barrières, s’explique par l’intensité de l’activité agricole (« La Ceinture dorée » du Haut-Léon, fig. 2).
Les gares
Taulé
Encadrement des ouvertures et chaînages d’angle en granite de Cléder. Moellons, au moins pour partie, en leucogranite à tourmaline dit de Sainte-Catherine.
Taulé-Henvic
Gare avec étage. Soubassement, encadrement de la porte et bandeau en granite de Cléder. Moellons en leucogranite à tourmaline de Sainte-Catherine.
Henvic-Carantec
Encadrement des ouvertures et chaînages d’angle en granite de Cléder (faciès Moguériec, à grain plus fin).
Plouénan
Encadrement des ouvertures en granite de Cléder. Moellons de la partie inférieure en leucogranite à tourmaline.
Saint-Pol-de-Léon
Le bâtiment central, à un étage, est flanqué, de chaque côté, d’une annexe avec uniquement rez-de-chaussée. Dans l’ensemble de la construction, appel a été fait pour les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures au granite de Cléder ; pour les moellons au granite à tourmaline de Sainte-Catherine.
Roscoff
Au terminus de la ligne, construction très soignée, inaugurée en 1883. Pierres d’angle, assise basale, bandeau, entourage d’ouvertures, en granite de Cléder. Moellons, au-dessus de l’assise basale, en granite à tourmaline type Sainte-Catherine. Une partie des encadrements des ouvertures est en granite à muscovite de l’Île Grande. La murette de l’enclos de la gare est en moellons de granite gris de Roscoff, couronnée par une tablette en granite dit de Cléder. L’ensemble reflète un net polylithisme granitique.
Les gardes-barrières
Environ la moitié des bâtiments est succinctement présentée.
Le bâtiment situé au nord-est de Sainte-Sève, en contrebas de la voie express R.N. 12, a fait appel au granite du Ponthou (une des venues du massif polyphasé de Plouaret), facilement identifiable par ses longs feldspaths blanchâtres plus ou moins alignés.
Kerveur (Passage à niveaux (P. N.) 6)
Chaînage d’angle et encadrement des ouvertures en granite fin à muscovite de Guerlesquin, dans le massif de Plouaret.
ESE-Taulé. (P. N. sur la D. 769)
Chaînage d’angle en granite de Cléder ; encadrement des ouvertures en granite de Guerlesquin.
NE Taulé à Ty Nevez ar Rest
Pierres d’angle et encadrements des ouvertures en granite de Guerlesquin.
NNE Taulé à Meziou Meur (P. N. 9)
Chaînages d’angle et encadrements des ouvertures en granite de Guerlesquin.
SSE Henvic près Parloas (P. N. 11 daté de 1882)
Chaînages d’angle et encadrements des ouvertures en granite de Cléder.
SW Henvic, à Kervranic (P. N. 13)
Pierres d’angle et d’ouvertures en granite de Cléder.
WSW Henvic, W Coat-Glas (P. N. 14)
Pierres d’angle et d’ouvertures en granite de Guerlesquin.
P. N. 21
Pierres d’angle et d’ouvertures en granite de Cléder.
P. N. 23
Pierres d’angle et encadrements des ouvertures en granite de Cléder.
P. N. 24 (Pemprat)
Granite de Cléder en pierres d’angle.
P. N. 25 (près de l’entrée de la gare de Roscoff)
Pierres d’angle et d’ouvertures en granite de Cléder.
Ligne Carhaix-Morlaix
(La gare de Carhaix est présentée (infra) dans le chapitre consacré à la ligne Loudéac-Carhaix-Châteaulin).
Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs infrastructures ferroviaires sur la ligne à voie étroite Carhaix-Morlaix à l’est du Huelgoat, ont fait appel à ce granite. Ainsi pour la gare de Berrien-Scrignac, assises inférieures en pierre de taille, les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures étant en briques rouges ; de même pour la gare de Locmaria-Berrien (assise inférieure en granite du Huelgoat).
Ligne Loudéac-Châteaulin
Seuls quelques sites ont été examinés sous l’angle lithologique (fig. 5).
La gare de Loudéac desservait également la ligne à voie normale Saint-Brieuc-Pontivy. Elle se singularise par le soin apporté au façonnement des pierres de soubassement, chanfreinées, en leucogranite de Pontivy.
Gouarec
Le soubassement de la gare est formé par trois assises en pierres de taille façonnées dans le leucogranite de Pontivy. La bordure du quai est couronnée par des pierres de taille en ce même leucogranite, surmontant un parement de moellons polygonaux en diorite de Plélauff. Les encadrements des ouvertures sont en briques rouges.
Plouguernevel
Le soubassement est formé par trois assises en pierres de taille en diorite de Plélauff (photo 8).
Photo 8 - Gare de Plouguernevel. Trois assises en diorite de Plélauff
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris, 11 juin 2016
Rostrenen
Le bâtiment principal montre trois assises en pierres de taille façonnées dans le granite de ce nom ; dans le bâtiment latéral, cordon en diorite de Plélauff sur moellons polygonaux en granite de Rostrenen.
Carhaix
Cette gare était un nœud ferroviaire important. Le soubassement est formé par quatre assises particulièrement soignées en granite du Huelgoat. Encadrement des ouvertures et chaîne d’angle en briques rouges.
Pont-Triffen
La station Spézet-Landelau montre trois assises en pierres de taille ayant mis en œuvre un leucogranite à grain moyen, en provenance du Morbihan, mais dont l’origine précise n’a pu encore être déterminée. Chaînage d’angle et entourage des ouvertures en briques rouges.
Châteauneuf-du-Faou
La gare présente trois assises basales en granite du Huelgoat. Chaîne d’angle et encadrement des ouvertures en briques rouges.
Lennon
À 2,5 km du bourg, la gare a également fait appel à la brique rouge ; les trois assises du soubassement sont encore en granite du Huelgoat, ainsi que la marche à l’entrée. Située un peu à l’est de la gare, la maison gardes-barrières offre un soubassement en moellons de grès proximaux verts ; toutefois, les deux marches à l’entrée sont en granite du Huelgoat ; en contrebas, le mur du sous-sol (« cave ») est également en moellons de grès vert.
Pleyben
Dans un bâtiment annexe de la gare, le granite du Huelgoat ne constitue qu’une unique assise basale ; la marche d’accès, en la même roche, dépasse deux mètres de long.
Resterniou
La maison gardes-barrières entre Pleyben et Saint-Ségal offre une assise inférieure en grès vert, tandis que le seuil de l’entrée est un monolithe en granite du Huelgoat. Dans la gare de Saint-Ségal, trois assises en pierres de taille en granite du Huelgoat.
Châteaulin-Ville
Juste à l’est du viaduc curviligne sur l’Aulne, assises basales en granite du Huelgoat.
Les autres gares ou stations offrent, dans l’ensemble, un modèle semblable, juxtaposant bâtiment pour les voyageurs et bâtiment pour les marchandises. Mis à part les soubassements, en pierres apparentes, le crépi des murs masque la nature des matériaux ; les chaînages d’angle et les encadrements des ouvertures sont en briques rouges.
Saint-Caradec
Cordon en pierres de taille façonnées dans le leucogranite de Pontivy sur quelques assises en moellons de même nature.
Saint-Guen
Bâtiment principal, avec trois assises en leucogranite de Pontivy ; soubassement de la partie latérale, schistes de Saint-Guen, altérés.
Caurel
Quelques assises basales en pierres de taille, en leucogranite de Pontivy.
Malgré le caractère incomplet des recherches, l’analyse lithologique des ouvrages de la ligne Loudéac-Carhaix-Châteaulin (y compris les ouvrages d’art non présentés ici) permet de présenter quelques conclusions.
En premier lieu, les exigences exprimées par les ingénieurs des Ponts et Chaussées sur la qualité des pierres utilisées, se sont traduites, le plus souvent, par l’appel à des matériaux de provenance relativement lointaine. Le handicap de l’éloignement, très sévère alors pour les acheminements par charrois, était toutefois ici, au moins en partie, atténué par l’utilisation du canal de Nantes à Brest, situé, localement, à des distances modérées, voire faibles, tant des chantiers d’extraction que d’exécution. Le cas le plus spectaculaire est celui de la diorite de Plélauff : la carrière de Guendol était ouverte à proximité de la voie d’eau. Et ce même canal a joué aussi un rôle essentiel pour l’acheminement du leucogranite de Pontivy jusqu’à Châteaulin. Le kersanton de la rade de Brest pouvait être transporté par l’Aulne navigable.
Second point, également très frappant, la diversité des pierres recherchées : leucogranite de Pontivy, granite du Huelgoat, leucogranite du Menez Gouaillou, diorite de Plélauff, kersanton de Logonna-Daoulas ; dans une moindre mesure, granite de Rostrenen et de l’Aber-Ildut, sans compter les moellons extraits dans les tranchées et dans des carrières locales : schiste gréseux et grès vert du bassin de Châteaulin… Par ailleurs, le changement de carrières pour le viaduc de Châteaulin est symptomatique des impératifs financiers qui rendent compte de l’abandon de la diorite de Plélauff au profit du kersanton nettement plus proximal, mais aussi de l’abandon du granite du Huelgoat qui devait être acheminé « par terre » alors que le leucogranite de Pontivy pouvait bénéficier du canal. Cette diversité s’est traduite par un polylithisme, non seulement à l’échelle de l’ensemble des ouvrages, mais même dans un seul ouvrage ; les exemples, déjà décrits, sont trop nombreux pour être repris ici. Évoquons toutefois, parmi bien d’autres, le cas du viaduc de Daoulas avec l’emploi dans les parements vus de la diorite de Plélauff, du granite de Rostrenen et du leucogranite de Pontivy.
Le cas de la diorite de Plélauff mérite de retenir plus longtemps l’attention. Cette belle pierre avait été utilisée quelques dizaines d’années auparavant pour les parements vus du viaduc de Guily Glas, aux environs de Châteaulin, pour le passage de l’Aulne de la voie ferrée Quimper-Landerneau. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les ingénieurs aient fait appel à nouveau à cette superbe pierre qui avait acquis ses titres de noblesse. La même remarque peut être formulée pour le granite du Huelgoat qui, dans la première partie du XIXe siècle avait été très largement employé, avec succès pour les écluses du canal. Cette superbe roche est très fréquente tant dans les ouvrages d’art que dans les soubassements des gares, dans la partie occidentale de la ligne.
L’exécution de la voie ferrée Loudéac-Carhaix-Châteaulin à la charnière XIXe – XXe siècles répond, en fait, à une nouvelle tentative en vue du désenclavement de la Bretagne centrale, que s’était déjà efforcé de procurer le canal de Nantes à Brest dans la première partie du XIXe siècle. Ces deux modes de communication sont devenus aujourd’hui obsolètes, mais leurs traces architecturales dans l’environnement méritent d’être soigneusement entretenues. Le cas est en cours de réalisation pour le canal ; l’ancienne voie ferrée devra aussi bénéficier d’un traitement de faveur dans le cadre d’une conservation bien comprise du patrimoine à laquelle s’adjoint un atout touristique indéniable.
Ligne Châteaulin – Camaret
Construite entre 1896 et 1925, et fermée en 1967, l’ancienne ligne à voie étroite du Réseau breton (52 km) ne peut manquer de frapper l’observateur par l’originalité de ses gares et de ses stations, s’écartant nettement du type « classique » : Dinéault, Plomodiern, Saint-Nic, Argol (halte), Telgruc, Tal-ar-Groas, Crozon, Perros (halte), Le Fret, Camaret.
Mais l’étonnement croît en prenant conscience de la qualité tout à fait exceptionnelle du bâti où la pierre a été mise en œuvre non seulement avec profusion, mais aussi avec soin, voire avec une certaine recherche artistique dont témoignent les curieuses cheminées surnommées, en raison de leur forme élancée, « Les bigoudènes » par les cheminots. La surprise est totale en constatant l’appel généralisé pour le grand appareil, au superbe granite de l’Aber-Ildut, facilement identifiable par ses gros feldspaths de teinte rose et ses enclaves oblongues gris-noirâtre.
Une partie au moins de ce granite a été extraite dans la carrière « Martin », ouverte sur la rive méridionale de l’Aber-Ildut, ainsi que le laisse entendre une lettre de Georges Huet, propriétaire de ladite carrière, en date du 30 mars 1928 (Archives de l’ancienne École Navale à Brest) :
« J’ai assuré la fourniture pour l’entreprise Guigues à Crozon, d’un appareil de taille assez compliqué destiné aux gares de Crozon et de Camaret ».
Dans la même lettre, G. Huet apporte des précisions sur le transport par mer du granite.
« Ma carrière – écrit-il – située sur l’Aber même, assez haut sur celui-ci, permet l’accès à quai […] de navires marins […] en particulier de gabares […]. Sa situation en amont la protège contre les tempêtes du large et permet d’y travailler sans aucune sujétion due à l’état de la mer ».
Plus loin, il ajoute :
« J’ai pour le transport par mer, une entente de principe avec deux marins, propriétaires de gabares pouvant porter 50 à 60 tonnes, soit 20 à 25 m3 ».
Le port de débarquement du granite de l’Aber-Ildut, mis en œuvre dans la construction des gares, ne nous est pas connu ; selon toute probabilité, il s’agit du Fret.
Pour la pierre de taille, toutes les gares de la ligne ont utilisé le granite de l’Aber-Ildut qui tend à leur conférer, avec leur architecture particulière, une homogénéité frappante (la gare de Dinéault est aujourd’hui presque entièrement crépie, toutefois le soubassement localement visible, est également en granite de l’Aber-Ildut). Ces pierres de taille, façonnées avec le plus grand soin, sont réservées aux encadrements des ouvertures, rampants, cheminées, marches, bordures de trottoir… ; les moellons, aux soubassements. Leur qualité est telle qu’elles apparaissent avoir été extraites tout récemment.
La nature pétrographique des moellons mis en œuvre dans les gares est plus diversifiée. En sus du granite de l’Aber-Ildut, déjà évoqué, ont été recherchés : le grès armoricain (Dinéault, Plomodiern, Telgruc, Tal-ar-Groas, Crozon) ; le microgranite de l’Île Longue (Camaret, Le Fret) ; les quartzites gris-vert, veinés de quartz blanc du Gédinnien, étage du Dévonien (Saint-Nic ; Tal-ar-Groas : photo 45). Ces roches sont souvent façonnées en éléments à contours pentagonaux ou hexagonaux qui contribuent, à leur tour, à l’originalité des bâtiments. Sauf erreur de notre part, à Tal-ar-Groas, deux assises paraissent avoir été exécutées en microgranite de Logonna.
La halte de Perros, près de l’étang de Kerloc’h, est totalement différente des gares précitées ; encadrements des portes et chaînage d’angle en briques rouges ; seuil de la porte en granite rose de l’Aber-Ildut ; soubassement en microgranite de l’Île Longue. La halte, dite « gare d’Argol », a fait un large appel aux briques rouges.
L’examen systématique des maisons gardes-barrières n’a pas été entrepris. À titre d’exemple, un peu à l’est de Dinidic en Plomodiern : soubassement en beaux moellons leucogranitiques, de provenance imprécisée ; chaînage d’angle et encadrements des ouvertures en briques rouges.
Autres Lignes À Voie Normale
Située à l’extrémité de la ligne en provenance de Rosporden, la gare de Concarneau, ouverte en 1883, est aujourd’hui hors service. Mise en œuvre avait été faite pour la pierre de taille (soubassement, chaînages d’angle, encadrements des ouvertures et corniche) du granite à gros grain dit de Trégunc qui affleure à proximité et qui est considéré comme le plus beau granite de toute la région.
La gare de Pontivy
Inaugurée en 1864, elle présente un soubassement de cinq assises en pierres de taille façonnées dans le leucogranite porphyroïde à gros grain proximal, surmonté par une alternance de briques rouges, et de tuffeau localement desquamé.
Saint-Nazaire
L’ancienne gare de la Compagnie d’Orléans est un superbe bâtiment de style haussmannien, remontant au début de la seconde partie du XIXe siècle (photo 9). Sa luminosité est due à la mise en œuvre de deux calcaires différents ; le tuffeau du Val de Loire, très blanc, atteint par la desquamation ; la provenance du second, plus résistant, au toucher un peu graveleux n’a pas été déterminée.
Photo 9 - Ancienne gare de Saint-Nazaire
Bâtiment de style haussmannien, mettant en œuvre deux calcaires différents : le tuffeau du Val de Loire, très blanc, sensible à la desquamation ; un autre calcaire, plus résistant, de provenance indéterminée.
Crédits photo : Louis et Marie Madeleine Chauris
La gare actuelle, mise en service en 1954, a employé, en élévation, de petits moellons plats façonnés dans un gneiss à grain fin, gris à brunâtre, indiquant qu’après la dernière guerre, appel a été fait encore, parfois, aux pierres locales.
Le Croisic
Les bordures du quai de la gare sont façonnées dans un granite à grain fin, à muscovite, en provenance possible de la carrière de Clis. Le soubassement de la gare présente une assise granitique. Les encadrements des ouvertures sont, selon toute probabilité, en tuffeau, peint ultérieurement, pour contrarier l’altération. Dans un petit bâtiment annexe, chaînage d’angle et granite à grain fin. En un mot, association de pierres proximales (granite) et distales (tuffeau).
La Baule-Escoublac
La « nouvelle » gare (1927) a fait un appel au lointain granite porphyroïde à cordiérite du Huelgoat (Finistère), très en vogue à cette date (construction de l’École Navale à Brest).
Épilogue
À l’issue de ces annotations, sans doute quelque peu fastidieuses, car, inévitablement , localement répétitives, et en dépit de leur caractère, à l’évidence, encore très incomplet, quelques remarques de portée plus générale peuvent être cependant présentées en conclusion.
L’emploi d’un matériau de provenance aussi distale que le tuffeau du Val de Loire n’est pas, a priori, sans surprendre ! Mais il faut remarquer que les voies méridionales de la province étaient déjà en relation, via Nantes, avec les sites d’extraction. Selon toute probabilité, cette roche, de façonnement très facile, a dû être acheminée, par fer, sans grand frais. En fait, le tuffeau a été largement recherché pour les bâtiments des lignes méridionales (gares, mais aussi gardes-barrières) sauf pour les soubassements.
La facilité de son façonnement due à la faible dureté de la roche a, toutefois, une contrepartie fâcheuse, à savoir la desquamation et l’effritement qui déparent ces constructions, alors que les pierres bretonnes du soubassement (leucogranite de Quéménéven, kersanton gris à Hanvec, granite rose de l’Aber-Ildut à Dirinon…) sont restées intactes.
Peut-être les ingénieurs étaient-ils aussi sensibles à l’attirance de cette roche que devait, ultérieurement , évoquer, mieux, chanter, Julien Gracq, dans « Un balcon en forêt », (Paris, Édit. J. Corti, 1958) :
« Cette craie tuffeau blanche et poreuse, tantôt desséchée et craquante au soleil, tantôt attendrie, exfoliée, desquamante dans l’humidité […], marbrée de gris fumés très délicats, d’imprégnations grumeleuses de buvard, mordue dans ses anfractuosités des très fines moisissures indurées du roquefort […] matériau féminin, pulpeux, au derme profond et sensible, tout duveté des subtiles impressions de l’air ».
Les résultats de l’analyse lithologique des bâtiments sur la ligne Morlaix-Roscoff s’avèrent d’un intérêt particulier et sont à présent synthétisés avec quelques détails à titre d’exemples. La diversité des pierres utilisées entraîne un grand nombre des sites d’extraction, tant proximaux que distaux. Mais ces deux constations sont loin d’être aléatoires. Le report systématique sur la carte montre que l’emploi de ces diverses roches dans les différents ouvrages de la ligne obéit en fait à une logique sous-tendue par les impératifs économiques et techniques, liés d’une part à la distance, d’autre part à l’aptitude au façonnement des matériaux recherchés. Quelques exemples suffiront pour expliciter notre manière de voir. Ainsi, l’utilisation préférentielle du granite de Cléder comme pierre de taille se localise dans la partie septentrionale (voire médiane) de la ligne, secteur le plus proche des sites d’extraction ; dans la partie méridionale de la ligne, les maisons des gardes-barrières ont eu, au contraire, tendance à privilégier le granite des environs de Guerlesquin : avec l’éloignement des carrières, le granite de Cléder devenait ici de moins en moins compétitif… De même, pour les moellons des parements vus a-t-on utilisé, en fonction des distances, soit le granite fin à tourmaline (en particulier aux environs de Saint-Pol-de-Léon), soit le granite gris de Roscoff (à proximité des carrières littorales).
Trois granites méritent quelques précisions supplémentaires :
Des environs de Saint-Vougay (Sainte-Catherine) à la grève de Kerigou en Saint-Pol-de-Léon s’étend une longue et étroite bande de granite blanchâtre, le plus souvent à grain fin, caractérisé par sa richesse en cristaux allongés bleu-noir de tourmaline qui, par contraste, rehaussent encore sa clarté. Cette roche est connue sous le nom de granite de Sainte-Catherine (du nom d’un hameau de Mespaul où les carrières étaient particulièrement fréquentes). Au sud de la ville de Saint-Pol-de-Léon, les points d’extraction étaient également nombreux, tant sur l’estran (Kerigou) que dans les terres (Penquer, Kerivoal, Kerasplam, Penlan…). Nos observations ont établi que c’est de l’un (ou de plusieurs) de ces sites que provient une partie des moellons utilisés dans différentes constructions de la ligne : soubassement des gares et stations de Saint-Pol, Roscoff, Plouénan et Taulé-Henvic. Ces observations in situ ont été pleinement confirmées par les données d’archives (ADF 5 S 65) citant les carrières de Penlan et de Kerasplam.
Le massif granitique de Cléder qui s’étend largement à quelque distance à l’ouest de Saint-Pol-de-Léon a fourni dans le passé une remarquable pierre de taille. Vers la fin du XIXe siècle, 200 ouvriers travaillaient cette roche de qualité, très estimée dans le Haut-Léon. La pierre, de façonnement aisé, était généralement obtenue à partir du débitage d’énormes boules, disséminées aussi bien au bord de la mer que dans les terres. Le granite de Cléder qui offre une légère tendance porphyroïde, a été très recherché pour fournir des éléments de grand appareil à divers ouvrages de la ligne Morlaix-Roscoff : gares de Saint-Pol-de-Léon et de Roscoff (pierres d’angle, encadrements des ouvertures…), stations de Plouénan et de Taulé-Henvic… ; maisons de gardes-barrières dans la partie nord et médiane de la ligne (également pour pierres d’angle et entourages des ouvertures).
Ce sont des environs de Guerlesquin – Loguivy-Plougras dans le massif granitique polyphasé de Plouaret (Côtes-d’Armor) que provient le granite à grain fin, blanc gris-clair, plus ou moins riche en muscovite (mica blanc), utilisé en pierres de taille (angle, ouvertures) dans la plupart des maisons de gardes-barrières de la partie sud de la ligne. À cette époque, l’extraction et le façonnement de ce granite occupaient un grand nombre d’ouvriers dont la production était acheminée dans toute la région. Cette roche, susceptible de fournir, sans grande difficulté, de telles pierres de taille, était alors, en quelque sorte, le concurrent oriental du granite de Cléder.
La mise en œuvre du kersanton, « la pierre-reine », selon le célèbre ingénieur Léonce Reynaud, dans la partie occidentale de la région examinée ici, mérite aussi quelques commentaires (fig. 2).
Sur la ligne Brest-Morlaix, malgré la concurrence de granites d’excellente qualité, l’emploi du kersanton se prolonge assez loin vers l’est, puisqu’il a été reconnu dans la maison gardes-barrières du Treillic au sud-est de Guimiliau : un tel cas reste toutefois isolé. Beaucoup plus vers l’ouest ont été notés : le passage à niveau de Pont-Christ (où l’on admirera les cintres monolithes, curieusement recourbés des linteaux) ; les passages à niveau de Poul-ar-Velin et de Kergleuz à l’est du Relecq.
Sur la ligne Châteaulin-Landerneau, l’appel au kersanton revêt une particulière importance (dans les contreforts des ponts, et dans une moindre mesure des gares : Pont-de-Buis, Hanvec). En fait, devant les immenses besoins en pierres de taille et en moellons, exigés le plus souvent en un laps de temps très court (lignes Morlaix-Brest et Landerneau), le kersanton ne pouvait, à l’évidence, subvenir seul à la demande. D’où appel à d’autres roches, comme le granite de Kersaint-Plabennec (pour les environs de Landerneau) ; le granite de l’Aber-Ildut, en particulier pour le viaduc de la Mignonne près de Daoulas – et en partie pour le viaduc du Relecq-Kerhuon (carrières des environs de Plouguin) ; et même, fait a priori surprenant, la granodiorite de Plélauff (dans les Côtes-d’Armor actuelles) pour le viaduc de l’Aulne près de Guily-Glas et de la Douffine, près de Quimerc’h – dans ces deux derniers cas, les pierres étaient acheminées par le canal de Nantes à Brest.
La diffusion extraordinaire du lointain tuffeau dans les bâtiments du chemin de fer (gares, gardes-barrières) en Bretagne méridionale ne doit pas masquer la mise en œuvre de très nombreuses roches régionales, soit proximales, soit distales, tant en moellons qu’en pierres de taille. L’impact du grès armoricain, blanchâtre, de la presqu’île de Crozon sur la ligne Châteaulin-Camaret a été précisé. Plus inattendu, l’appel au schiste bleu de Nozay pour la gare de Nantes et au schiste rouge du Pays pourpre pour la gare de Lorient, localement au grès vert du bassin de Châteaulin. Quelques massifs granitiques ont été principalement appréciés : tels ceux du pluton polyphasé de Plouaret avec ses différents faciès : granodiorite de Bégard, granite à grain fin de Guerlesquin, granite porphyroïde du Ponthou. L’emprise du granite de Cléder a déjà été remarquée. Le cas du granite porphyroïde d’Allaire, aujourd’hui tombé dans l’oubli, se doit d’être rappelé. Mais bien d’autres granites bretons doivent être évoqués : Saint-Brieuc, Languédias, Rostrenen, Pontivy, Huelgoat, Aber-Ildut… Cette richesse en superbes pierres naturelles rend d’autant plus étonnant – voire affligeant – l’appel à la brique rouge, pierre artificielle… Question de mode contre laquelle la Nature lutte difficilement…