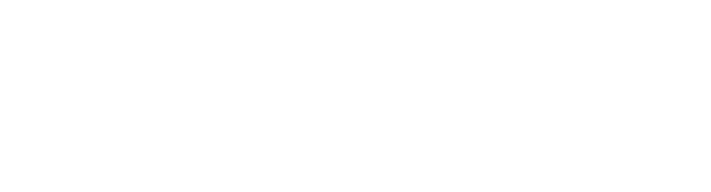Introduction
Entre les fleuves Saloum et Diomboss au cœur du delta du Sine Saloum se localisent les îles du Gandoule et particulièrement Djirnda. Il s’agit d’un archipel marqué par tous les critères de la périphéricité. Isolement, dépendances aux ressources, populations majoritairement paysannes ou dépendantes de la pêche. Les caractéristiques de la marge sont renforcées par l’insularité (photo 1). Ces îles appartiennent à la catégorie des petites îles définies par Françoise Péron puisque le faible nombre d’habitants permet de connaître l'ensemble de la communauté insulaire (Péron, 1998). Cette situation a permis l'émergence d'une identité Niominka, territoriale et culturelle forte à la marge méridionale du pays sérère. La commune est aussi soumise à une série de dynamiques qui traversent l'ensemble des zones rurales reculées au Sénégal, l'attraction de Dakar située à 2 heures de bus, de la ville régionale de Kaolack, mais aussi des localités du continent qui sont plus ouvertes au tourisme comme Joal-Fadiouth, Palmarin ou Ndangane réputée pour ses hôtels et comme base de départ des pirogues de touristes pour visiter le Saloum. D'autres tensions sont d'origines exogènes comme la mise en place des Aires Marines Protégées (AMP), les incursions plus nombreuses des pêcheurs originaires du Nord du Sénégal dans l'estuaire, l'essor récent de l'exploitation des hydrocarbures à 70 kilomètres au large de l'île de Sangomar.
La commune de Djirnda est située dans la partie centre Ouest du Sénégal, appelée Sine Saloum et couvre une superficie de 321 km2, composée des villages de Diamniadio, Djirnda, Ngadior, Fambine, Fayako, Felir, Moundé, Rofangue et Velingara. La commune est limitée par les communes de Djilor à l'est, de Dionewar à l'ouest, de Fimela et de Djilasse au nord et de Bassoul au sud (fig. 1).
Dans le cadre du projet de recherche H2020-MSCA-RISEPADDLE1, financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 portant sur la planification maritime au Sénégal, Djirnda en constitue un terrain de recherche mêlant une approche anthropologique et géographique. Cet article permet d'interroger un même terrain tantôt connu et familier ou au contraire neuf et inconnu selon les auteurs.
Méthodologie
La démarche méthodologique repose sur des entretiens et des focus group réalisés dans les 7 localités de l'AMP de Gandoule (fig. 1), composés des personnes-ressources autour de la gouvernance des ressources naturelles (conservateurs d'aire protégée, agents municipaux, chef de village, imam, pêcheurs et guides touristiques). Trois focus group ont été réalisés à Djirnda et un à Diamniadio composés d'une dizaine d'acteurs (hommes et femmes). La démarche ouverte et exploratoire permet de s'adapter aux particularités de chaque communauté ou types d'acteurs et de son implication dans l'AMP de Gandoule. Une partie des matériaux recueillis vient de l'observation participante auprès de certaines familles de Djirnda permettant de comprendre les stratégies mises en place sur les 10 dernières années. Dans le cadre du programme de recherche PADDLE, trois missions de terrain ont été réalisées sur l'île de Djirnda en 2022 et 2023.
Le traitement des données a été permis par l'utilisation de logiciels tels que ArcGis 10.5 pour la mise en page cartographique, QDA Miner Lite pour la transcription des entretiens. Des coordonnées géographiques à travers un GPS de type smart ont été prises pour une meilleure reconnaissance des limites des Aires Marines Protégées visitées (fig. 1). Les localités de Ndagane, Djifère, Dionwar Falia, Djirnda, Nghadior, et Diamniadio ont été visités dans le Gandoule. Cependant, l'île de Djirnda a fait l'objet d'une étude de cas plus poussée.
Des îles périphériques au cœur de l'estuaire du Sine Saloum
Les îles du Saloum constituent des lieux singuliers puisque l'insularité n'y apparait pas de prime abord. Si l'île barrière de Sangomar se dévoile, seule face au large, permettant d'apprécier ses contours, les autres îles séparées par des bras de mer ou par le large fleuve Saloum peuvent être assimilées dans un premier temps à un littoral bordé de mangroves. Il faut remonter les bolongs, correspondant aux bras du Saloum, de 2 km de large à quelques mètres quand il s'agit de bras mineurs, qui serpentent à travers une mangrove formée essentiellement de rhizophoras entremêlant leurs racines échasses. Pour autant, l'insularité n'est pas appréciable parce que l'on ne peut pas en faire le tour sans un détour de plusieurs heures en pirogue. Vue du ciel, l'île n’apparaît pas, mais s'agrège à d'autres terres qui pourtant au moment des fortes marées constituent un archipel. En effet, c'est finalement à pied, en traversant les larges étendues nues et blanches liées à la sursalinité (photo 1) que l'on se rend compte que l'on quitte la terre et donc une île et que l'on arrive sur une autre terre avec son village et donc une seconde île. Sans doute l'absence de hauteurs surmontant ces îles de sable rend également difficile l'appréhension des contours.
Photo 1 - Elèves de Nghadior et Fambine revenant du lycée de Djirnda situé à une heure de marche de chez eux
Crédit photo : M. Desse, février 2022
Pour autant, après 1h30 à 2 heures de pirogues en arrivant des ports de Ndangane, de Djifer ou de Foundiougne (Ndakhonga) sur la partie nord-ouest du Saloum, le ponton de Djirnda constitue la principale entrée de l'île et du village. Les grandes pirogues de transport y convergent, débarquant ses passagers ou des marchandises essentielles : parpaings, bouteilles de gaz, denrées alimentaires, parfois un âne. Sur le quai, les jeunes garçons d'une dizaine d'années jouent les équilibristes pour vider les pirogues, charger les cabriolets tirés par des mules et conduits par d'autres adolescents plus âgés. Et déjà il faut charger les pirogues qui repartiront bien vite. En débarquant, l'insularité porte ses marques, d'une temporalité différente, d'une rupture qui parfois confère à l'isolement quand l'harmattan souffle sur le Saloum rendant la navigation piroguière difficile.
Du ponton, le village de Djirnda qui accueille 3 600 habitants semble bien austère, une certaine pauvreté se dégage. Pauvreté d'un milieu sous tension qui s'élève à peine de l'eau de l'estuaire, marquée par l'absence d'arbres, de manguiers, de jardins, de cases. De même, si les amas de coquillages et le séchage du poisson attestent d'une forte activité de pêche, la prédation des milieux et l'érosion de la biodiversité sont palpables.
Les maisons sont en parpaing, couvertes de tôles, organisées le long de rues parfois rectilignes, une organisation qui renforce aussi sans doute cette impression d'une indigence prégnante. Pauvreté par l'absence de voitures, de motos, il n'y a pas de commerces, à part plusieurs épiceries de quelques mètres carrés et une boulangerie. La sursalinité des sols affecte la qualité des eaux de pompage ou des puits, mais ronge également toutes les constructions (photo 2), maisons en parpaing comme les puits maçonnés et nécessite une constante autoconstruction. La digue-barrages construite à l'est du village atteste de la menace grandissante de submersion marine (photo 3) qui pèse sur les villages de l'estuaire du delta du Saloum en raison du changement climatique.
Le système de production des populations locales apparaît en pleine mutation. L'agriculture, hormis un élevage de zébus et de caprins, a quasiment disparu et ne suffit plus pour nourrir les populations locales (salinisation et diminution des terres de culture, sécheresse, pression et spéculation foncière) ; un paysage quasiment amphibien avec une forte présence de vasières à mangroves, de terre salée (fig. 2).
Les sols fertiles n'existent pratiquement pas. Leur dégradation (photo 4) est due aux phénomènes physico-chimiques et anthropiques. Cette situation s'est produite dans un contexte de changement climatique depuis les années 1970.
Face à la pénurie, les populations ont transformé leurs prélèvements halieutiques de subsistance en une activité commerciale de rente dans un contexte de démographie croissante.
Dans ces conditions, la pêche, bien que victime de plus en plus de la rareté des produits halieutiques fortement surexploités, s'impose alors comme « l'activité principale » voire unique, notamment dans les îles (Diadhiou, 2002). Cette pratique est en outre amplifiée par l'apparition de technologies nouvelles écologiquement inadaptées (four de fumage) diffusées par des allochtones guinéens (Cisse et al., 2004). Les activités annexes à la pêche génèrent quelques emplois dans la réparation/entretien des pirogues, le séchage du poisson et la préparation des huîtres et crevettes pour la revente, exclusivement menées par les femmes. La diversification dans les activités touristiques demeure encore faible et ne s'accompagne pas de son lot d'activités induites (guide, artisanat, restauration, hébergement). Les infrastructures touristiques n'existent pratiquement pas dans la commune de Djirnda par crainte d'un risque de détérioration des valeurs sociales. Les jeunes s'activant dans le secteur touristique travaillent sur les sites touristiques périphériques à la commune comme Ndagane, Foundiougne, Mar Lothie, Dionwar.
Un autre marqueur de cette pauvreté est l'absence des jeunes hommes qui sont partis vers Dakar et qui pour certains tentent la traversée vers l'Europe. Certains parmi eux sont des pêcheurs séduits par la réussite des migrants clandestins (régularisés des années après), d'autres sont de jeunes étudiants n'ayant pas réussi à s'imposer à la faculté. Pour autant, la démographie demeure vigoureuse et les enfants les plus jeunes occupent les rues et les cours des maisons, les plus âgés travaillent au ponton (photo 5) et les autres fréquentent les écoles primaires et coraniques, le collège et le lycée, construits en dehors de l'agglomération. L'insularité et l'éloignement ont ainsi renforcé la forte identité villageoise.
Une forte appropriation territoriale : l'exemple de l'AMP de Gandoule
Le village de Djirnda dépend de l'AMP de Gandoule, créée en 2014, correspondant aux AMP récentes de la troisième génération reposant sur une forte intégration participative des populations. Ces dernières ont demandé la création de l'Aire Marine Protégée suite au constat de la baisse de la ressource et de la diminution des espèces. En 2021, au moment du renouvellement du comité de gestion, la superficie de l'AMP est passée de 15 500 ha à 28 121 ha ; d'autres communes ont adhéré expliquant l'extension de l'AMP en 2021. Les pêcheurs et les habitants se sont appropriés cette AMP. Le comité de gestion se réunit pour délimiter les zones de repos biologique, sur une base d'observations et de connaissances vernaculaires sans pour autant s'appuyer sur une base animiste comme c'est parfois le cas chez les Diola de Casamance (Thior et Desse, 2023). Ainsi, les bolongs de moins de 10 mètres de large constituent la partie protégée et sont interdits aux pêcheurs.
L'autre manière de s'approprier et d'être acteur de la protection de l'AMP réside dans la gestion de la zone de récifs artificiels immergés depuis 2017 en face du village et qui constitue une autre zone interdite à la pêche. Il s'agit de près de 400 petits récifs disposés tous les trois mètres constitués de gaules de palétuviers et de feuilles de palmiers rôniers, puis peu à peu remplacés par des modules en béton hérissés de tiges en fer. Ces récifs ont été immergés par une ONG de Gironde, Scaph Pro qui en réalise dans plusieurs pays en développement. Ce récif est surveillé par un comité de gestion et par certains pêcheurs formés par l'association pour effectuer des plongées de contrôle. Après quelques années, le bilan est extrêmement positif, marqué par le retour de poissons de grande taille, une plus grande variété d'espèces et un plus grand nombre d’huîtres et de coquillages.
Par ailleurs, les associations de jeunes comme Adaf Yungar de Ndjirnda protègent activement les ressources des mangroves et entretiennent des activités de réhabilitation. Le WWF a récemment engagé des jeunes dans la restauration et le développement durable des mangroves. L'organisation a permis aux jeunes de mener des activités de reboisement et de surveillance des mangroves dans divers endroits et les a impliqués (Socé, 2021).
L'autre élément dynamique réside dans les projets de développement touristique autour de la pêche sportive, la découverte des oiseaux depuis des observatoires en paillotes, la découverte du patrimoine historique. En effet, le Saloum est une zone qui accueille une avifaune extrêmement variée composée de pélicans, cormorans, sternes, mouettes, aigrettes, hérons, chevaliers, courlis vivant dans un écosystème globalement estuarien (fig. 3). Des circuits permettraient de montrer les reposoirs à oiseaux à Karane/île au Diable et île aux oiseaux (petite île devant Diamniadio), et le patrimoine historique de Maya. Il s'agit de 28 sites funéraires constitués d'amas coquilliers en forme de tumulus. L'AMP a déjà formé 7 écoguides susceptibles d'accueillir ces projets touristiques. Le tourisme apparait bien comme une solution de développement territorial afin de compenser la perte de l'activité agricole et la diminution des pratiques de pêche sur les zones de protection de l'AMP. Cette appropriation territoriale de la ressource serait inspirée du modèle réussi de gestion communautaire de Bamboung. C'est en réalité une initiative de conservation de la biodiversité aquatique. La concertation avec les pêcheurs artisans a permis l'acceptation du principe de création d'une aire marine protégée dans la région de Toubacouta au Sud du delta du Sine Saloum. Dans le cadre de cette démarche participative, les artisans-pêcheurs ont choisi le bolong de Bamboung. La délimitation précise de la zone protégée a été définie d'un commun accord entre l'Océanium (association sénégalaise de protection de l'environnement), les autorités sénégalaises et les pêcheurs. Par ailleurs, l'une des étapes de ce processus participatif a été la décision des villageois de fermer l'accès à la pêche dans le bolong (avril 2003) avec la création d'un comité de gestion, le balisage à l'entrée du bolong, la construction d'un mirador, l'achat d'une vedette permettant la mise en place d'une surveillance par des bénévoles selon un système de rotation (Breuil, 2011). On retrouve ainsi des pratiques similaires dans l'AMP de Gandoule.
Des projets plus lointains pourraient permettre de développer une filière artisanale et promouvoir le patrimoine artistique en particulier, la musique et la danse renouant ainsi avec les années passées quand un bateau de croisière venait. Les croisiéristes descendant à Djirnda visitaient le marché artisanal des femmes et assistaient à des spectacles de danse.
Si les jeunes ont rejoint les différentes instances de l'AMP lors des renouvellements de 2021, le départ de certains formés dans le cadre de l'AMP vers les villes ou l'étranger constitue un handicap et une fragilité. De même, si l'AMP ne sera pas touchée par l'exploitation du champ gazier de Sangomar situé à 70 km au large de l'estuaire du Saloum, les périmètres d'exploitation interdits à la pêche affectent les pêcheurs de Djirnda saisonniers à Djifer et Joal-Fadiouth qui fréquentent aussi la haute mer. Ceux qui exploitent les bolongs de l'estuaire craignent des désordres posés par le passage de pétroliers et de gros navires de maintenance qui rejoindront le nouveau port au pied du pont de Foundiougne et le dépôt de Ndakhonga (fig. 1). Leur passage risque de menacer en particulier les pêcheries de crevettes.
D'autres infrastructures récentes montrent des signes de dynamisme territorial. Venant du continent, un pipeline en partie immergé, flottant ailleurs, traverse le Saloum et permet d'apporter de l'eau aux villages de Djirnda et de Nghadior (photo 6). De même, une centrale photovoltaïque assure la distribution d'électricité. Enfin, le collège et le lycée permettent aux adolescents de Djirnda et de Nghadior de poursuivre leurs études.
Photo 6 - Pipeline d’eau et cheminement possible à marée basse à travers la mangrove
Crédit photo : M. Desse, février 2022
Les dynamiques sociospatiales de Djirnda au travers du modèle Exit-Voice and Loyalty
La lecture des enjeux territoriaux à travers le modèle Exit-Voice and Loyalty d'Albert Otto Hirschman permet de mieux appréhender les stratégies des habitants de Djirnda face aux évolutions spatiales et environnementales, entraînant des dynamiques de défection, de mobilité (exit), de protestations (voice), de fidélité et d'adaptabilité (loyalty) et enfin d'apathie dans un contexte de crises multiples (environnementale, sanitaire, sociale, économique, politique) marqué par une grande individuation des trajectoires (fig. 4).
Figure 4 - Les stratégies des habitants de Djirnda face aux évolutions spatiales du modèle Exit-Voice and Loyalty
Les deux premières notions de l'exit et du voice constituent deux réactions communes consécutives à une crise. L'exit ou défection est une réaction de fuite : l'individu sort du système d'interaction ici insulaire. Face aux pauvretés sociales, économiques, environnementales, les stratégies qui relèvent de la fuite sont essentiellement le fait des jeunes hommes. Partir entraîne la délocalisation géographique, mais aussi la perte de l'emploi, elle est souvent synonyme de déclassement économique et social. L'exit ne relève ici nullement d'un choix, il est lié à un événement subi, à l'absence de perspectives de développement. Cette solution peut se réitérer, en fonction des stratégies spatiales et économiques des individus (relevant de leur choix) ou en fonction des obligations, des pressions liées par exemple aux fermetures des frontières, au raccompagnement des migrants aux frontières.
Le voice, c'est-à-dire la prise de parole ou la protestation, constitue la réaction inverse : l'individu reste, mais il cherche à réduire ou à supprimer son mécontentement en essayant de changer le système d'interaction de l'intérieur. Les stratégies de type « voice de concertation » se sont bien développées dans le cadre de l'AMP par la mise en place d'un zonage d'activités et de pratiques, la surveillance et l'entretien de la zone de récifs artificiels. Dans les deux cas, le fait que la concertation s'opère avec un acteur extérieur, le représentant de l'AMP, l'ONG Scaph pro, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable afin de développer une pêche artisanale durable et l'accompagnement de la commune de Djirnda vers la réduction de sa dépendance à la pêche par la diversification de son économie locale peut expliquer que la concertation se passe bien et que les projets soient appropriés. De même pour les équipements de base : pipeline d'eau, centrale photo voltaïque, collège et lycée relèvent d'actions accompagnant les mesures de décentralisation.
Les stratégies de prise de parole et de confrontation sont peu nombreuses et permettent de réguler au mieux les conflits et de s'adapter à la situation dégradée. Ainsi, pour Hirschman, la protestation met en cause le contrôle social mais dans le but de rétablir les conditions d'une coopération plus satisfaisante. Elle est apparue en février 2022, en opposition avec l'installation du maire élu au siège du conseil municipal. Les jeunes militants de l'Alliance pour le développement du département de Foundiougne (ADDF) se sont opposés aux forces de l'ordre de Foundiougne, Danga Faye puis de Fatick et de Kaolack. Après la cérémonie d'installation et le départ des gendarmes, le climat socio-politique demeure hostile. Ces tensions montrent le besoin de maîtriser l'espace social par les insulaires tout en recherchant de nouveaux acteurs susceptibles de proposer un changement et des dynamiques nouvelles. La dissolution de la grande Coalition Benno Book Yakar et le ralliement de l'ADDF à la mouvance présidentielle à la veille des élections législatives anticipées du 17 novembre 2023 a redéfini l'espace sociopolitique de Djirnda.
La notion de loyalty (loyauté) ou d'adaptabilité constitue une troisième forme de réaction et regroupe les personnes qui tentent de s'adapter à la situation, qui se résignent à une certaine pauvreté comme ceux, parfois les mêmes, qui misent sur les projets de développement ou de protection de l'environnement. La loyauté remet peu en cause le système des interactions sociales et sociétales, ni le modèle économique.
Au contraire, l'apathie, qui est l'inverse de la protestation, n'ouvre pas sur le conflit et contribue ainsi à reproduire le contrôle social, mais provoque une détérioration de la coopération. Dans la mesure où il n'adhère plus à la finalité de la relation, où il profite de son statut, où il contribue peu ou mal à la réalisation des objectifs, où il ne prend plus d'initiatives visant à améliorer la qualité du produit de la coopération, l'individu apathique la détériore. Cette apathie peut être le fait de personnes jeunes ou âgées sans grands moyens qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. La misère, la maladie, le cumul des situations de crise expliquent ces comportements.
Cette approche des stratégies ne doit cependant pas conduire à une typologie trop figée. Dans le cas de notre analyse spatiale, de nombreuses formes d'hybridation apparaissent en fonction des individus, de l'intensité de l'impact de la pauvreté ou de la dérégulation climatique sur leur famille, de leur capital social et économique ainsi que des temporalités. Une même personne peut à la fois présenter des comportements d'apathie et d'exit. De même, en fonction des temporalités, ces personnes sinistrées peuvent passer d'un stade à l'autre, présentant des réactions évolutives.
Conclusion
Au regard des dynamiques territoriales actuelles, les populations insulaires du Gandoule ont toujours la propension à cultiver leur spécificité, pour mieux affirmer leur identité culturelle. Mais face à la mondialisation, les îles du Saloum ont connu l'émergence de nouvelles identités territoriales. Les récentes crises sociopolitiques, notamment au lendemain des élections locales très contestées par l'autre camp, ont reflété la vulnérabilité de leurs structures sociales témoignant des nouvelles relations de méfiance, bien que masquée, entre les membres d'une même communauté. Par ailleurs, même s'il est avéré qu'il y a une forte appropriation territoriale des ressources naturelles, il n'en demeure pas moins qu'avant la création de l'AMP de Gandoule, la gestion territoriale de la pêche avait échappé aux villageois. Le besoin de réguler les captures est urgent au regard des déprédations et les pousse à s'inspirer du modèle de gestion communautaire de Bamboung qui a incarné un nouveau mode de prélèvement halieutique.